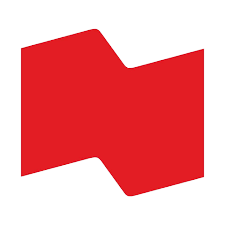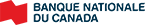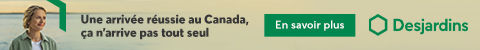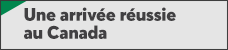O'Hana
Chroniqueur(e) immigrer.com-
Compteur de contenus
4081 -
Inscription
-
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Blogs
Tout ce qui a été posté par O'Hana
-
Salut gang, Pour ma part, je confirme : - que ton admission devrait théoriquement se faire sans problème au BEPP car ils ne demandent que le DEC ou l'équivalent du DEC sans autre conditions particulières. Avec ta formation, cela devrait donc passer sans difficultés - que le BEPP a une durée de 4 ans soit 8 sessions : la dernière année est presque exclusivement constituée que de stages en particulier la dernière session qui est un stage à temps plein Par ailleurs, vérifie auprès de l'université si tu ne seras pas obligé d'avoir la résidence permanente à la fin du bacc pour pouvoir travailler comme enseignant au Québec. Pour l'équivalence en France, il faudrait vérifier auprès du Ministère de l'Éducation. O'Hana
-
Salut gang, +1 Je n'ai pas trouvé l'info exacte mais cela pourra peut-être t'aider : composition d'Équipe Canada Turin 2006 par discipline Bien sûr qu'on s'en fout dans le fond et cela reste anecdotique comme je le précise dans la chronique Et il est tout à fait vrai effectivement que souligner particulièrement ce point - les femmes ont gagné plus de médailles que les hommes - peut être interprété comme une forme indirecte de machisme. Dans ce cas, ne rien dire aurait été alors l'expression d'une certaine équité. Mais dans ce cas, ne pas souligner la performance des hommes également pour justement maintenir l'équité ... "La liberté de l'un commence là où s'arrête de l'autre". Cela a fait mon affaire pendant bien des années car j'y voyais beaucoup de sagesse, de respect et de réciprocité (ce que j'y vois toujours d'ailleurs). Mais cela a perdu beaucoup de pertinence au jour où j'ai réalisé qu'on n'avait pas tous la même définition de la liberté et qu'à l'extrême, il y avait autant de conceptions de la liberté qu'il y a d'individus. Dans ce cas, avant de pouvoir juger que j'empiète dans les plates-bandes de l'autre ou que l'un rentre dans les miennes, nous devrions tous nous asseoir pour trouver une définition commune à ce terme. Bref, tenter de parler le même langage pour enfin sortir du dialogue de sourds. En ce sens, dans le cas du Québec à titre de pays hôte, j'adhère au concept d'interculturalisme québécois qui dit en substance "pacte entre l'immigrant et le Québec : nous offrons une structure d'accueil et d'intégration à l'immigrant en échange ce dernier reconnaît et accepte l'existence d'une culture dominante, soit celle québécoise". Pour moi, cela trace une direction générale qui est loin d'être rigide et ouverte aux transformations par le débat public et le respect de l'évolution des mentalités. O'Hana
-
Qu'est-ce que tu entends par "envoi sécurisé" ? Des gardes du corps tout autour de mon passeport durant tout son petit voyage jusqu'à Buffalo ? Sérieusement, je ne m'en rappelle plus. J'avais pris ce service - Express Post - (demande au bureau de poste) car c'était envoyé en code prioritaire et que j'avais une option de traçabilité par internet grâce à un numéro d'identification fourni par Postes Canada. J'aurai pu tout aussi bien m'adresser à Purolator ou UPS mais bon : Postes Canada était le premier rencontré sur ma route ce jour-là ... :-) O'Hana
-
Salut, Il y a trois ans, j'ai envoyé mon passeport à Buffalo depuis Sherbrooke. J'étais passé par le service Express Post de Postes Canada qui me permettait de suivre par internet le chemin que prenait mon passeport jusqu'à sa destination finale. Cela avait pris trois jours ouvrables. Buffalo l'avait reçu un mardi en fin de journée je crois : le lendemain mercredi, ils l'avaient reposté et je l'ai reçu une semaine plus tard par la poste régulière. O'Hana
-
Augmentation aucunement justifiée à mes yeux si elle n'est basée que sur cet argument que tu nous amènes Jimmy Nous parlons ici d'une société d'État et non d'une société privée. Et nous parlons également d'une société rentable (ce qui n'est pas le cas de la SAAQ par exemple qui songe à augmenter le coût des permis de conduire pour lutter contre son déficit budgétaire). O'Hana
-
Je n'ai pas prétendu le contraire D'où mon choix du terme "étudiant non-étranger" car : 1) un étudiant non citoyen canadien mais résident permanent a aussi droit à l'aide financière aux études de la province où il étudie 2) et plus précisément ici, un résident permanent qui étudie et qui vit au Québec a droit au programme de l'aide financière aux études du Québec comme l'indique le lien qu'a mis Demetan Donc, le terme "non étranger" m'apparaissait le plus adéquat car il englobe autant l'étudiant citoyen canadien et/ou québécois OU résident permanent au pays. Hors de ces trois statuts - excepté le statut d'Indien - la personne est considérée étudiante étrangère. Le reste de ta réflexion est pertinente dans un sens mais elle se pose davantage sur un plan sociologique ou culturelle alors que je fais référence dans ce fil de discussion au plan strictement juridique (un résident permanent n'est pas un étudiant étranger objectivement même si, subjectivement, il est en effet un étranger au sens de la citoyenneté canadienne et qu'il peut se sentir étranger à la culture canadienne ou québécoise). Entéka ... O'Hana
-
Généralement (i.e. pour un processus d'évaluation d'un étudiant ayant fait sa scolarité collégiale au Québec), l'admissibilité se fait sur la base de la qualité du dossier scolaire : plus le dossier est bon, plus l'étudiant a des chances de se voir offrir une place. Cette qualité se mesure essentiellement autour de la cote de rendement collégial (CRC) ou plus communément appelé la cote R. La cote R est le résultat d'un calcul complexe effectué par le MELS lui-même où sont pris en compte les notes de l'étudiant bien entendu mais également la force du groupe dans lequel il se trouve et une pondération tenant compte du programme dans lequel il se trouve. Ceci permet de maintenir une équité entre tous les étudiants au Québec. Sinon, ça serait les étudiants en sciences pures qui seraient largement favorisés par rapport aux étudiants des autres programmes par exemple. Bref, plus le programme est contingenté, plus la cote R minimal demandée sera élevée (ex : en médecine, la cote R minimale tourne autour de 33-34 - pour un maximum de 40 environ - ce qui représente une moyenne générale durant tout le cégep de 90% au moins). Pour les personnes n'ayant pas fait leurs études au Québec (donc, n'ayant pas de cote R), je suggère fortement de prendre contact avec le responsable du département dont dépend la formation contingentée qu'elles souhaitent suivre. Cela permettra à la personne de "défendre son cas" en présentant c.v., diplôme original, relevés de notes et description des cours suivis, bref, tout document de performance scolaire permettant de compenser l'absence d'études québécoises et de cote R. Ainsi, si le responsable en question accède de vous admettre dans le programme, lorsqu'il ou elle recevra votre demande par voie officielle via le Registrariat de l'université, il apposera son accord à votre admission car il aura préalablement évalué votre profil et pourra donc décider en connaissance de cause. Cependant, plus la cote R minimale demandée est élevée, moins les chances d'être accepté seront grandes si vous avez fait des études hors-Québec. Car cela signifie que la demande pour ce programme contingenté est grande et il est certain que l'Université ne prendra pas de risques. Généralement, au-dessus d'une cote R de 27, ça commence à devenir "du sérieux" et tout dépend du nombre de places offertes (une amie me disait qu'en design graphique à l'Université de Montréal il y a cinq ans, ils prenaient 60 étudiants sur les 700 demandes reçues !). Dépendamment des formations, ils peuvent demander autre chose : passer des tests physiques (bacc en éducation physique), présenter un portfolio (bacc en design graphique). On peut aussi appliquer comme candidat adulte (ne pas avoir les préalables exigés mais compenser par une expérience professionnelle en adéquation avec la formation visée) ou candidat universitaire (avoir déjà suivi ou complété des études universitaires). Mais dans tous les cas, c'est presque du cas par cas et l'Université a souvent le dernier mot. O'Hana
-
Salut floma, Si mes explications te paraissent encore floues, c'est peut-être parce que je me suis limité à la demande de Mayara qui souhaitait savoir les formations disponibles et pas nécessairement les conditions d'admission à ces formations À mon opinion, ton Bac B correspond à un DEC pré-universitaire en Sciences Humaines Profil Réalités Internationales ou Dynamiques Sociales au Québec. C'est ce qui me semble le plus approchant de l'orientation économie de ton bac français. Quant à ton BTS Action Commerciale, il pourrait correspondre à une Technique Administrative (aussi au niveau collégial) en gestion de commerce par exemple. Pour entrer au BEPP, cela prend un diplôme collégial (DEC pré-universitaire par exemple) et il n'y a pas de préalable en particulier qui est exigé. À ce titre, je te suggère de prendre contact avec le département de pédagogie de l'Université où tu désires étudier pour parler au responsable du BEPP afin que ce dernier puisse évaluer ton admissibilité. Attention : le BEPP est un baccalauréat contingenté. Cela signifie qu'il y a un nombre limité de places offertes à chaque année. O'Hana
-
Salut Queenie, À titre d'étudiant non-étranger et vivant au Québec, tu as droit à l'Aide Financière aux Études : AFE Ce programme provincial - appelé communément "les prêts et bourses" - a été mis en place pour soutenir financièrement les étudiants dans leur cheminement scolaire. Une rencontre avec un agent de l'AFE (il existe un centre AFE dans chaque établissement d'enseignement du Québec) te permettra de calculer le montant d'aide auquel tu auras droit en distinguant la part de bourse de celle de prêt étudiant. O'Hana
-
Salut Mayara, Cela dépend à quel ordre d'enseignement tu désires travailler : - Préscolaire et Primaire : baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire (BEPP) d'une durée de quatre ans à l'université. Formation didactique en mathématiques, français, arts plastiques, sciences humaines, éthique et culture religieuse avec évidemment des stages comme activités intégratrices - Secondaire : baccalauréat en enseignement secondaire d'une durée de quatre ans à l'université. Après une formation de tronc commun (didactique et pédagogie), il faut se spécialiser dans l'un des domaines suivants : Français langue d'enseignement - Univers social (Histoire Géographie) - Mathématiques - Sciences et Technologies (Informatique, Chimie, Physique, Biologie). À noter que les deux derniers profils (Maths et Sciences) exigent des préalables en sciences pures. Ces deux premiers diplômes sont nécessaires pour obtenir le permis d'enseigner dans les écoles primaires et secondaires du Québec. Le MELS considère en outre que la pédagogie est plus importante que le contenu à enseigner dans ces deux niveaux d'enseignement. Collégial : un baccalauréat et/ou une maîtrise dans le domaine d'enseignement avec, généralement appréciée, une formation en pédagogie pour les DEC pré-universitaires en général (français, histoire, chimie, mathématiques, sociologie, économie, philosophie, arts et lettres, etc). Pour les techniques, cela devient plus compliqué, car il existe depuis quelques années un baccalauréat en enseignement professionnel (durée de 4 ans) avec un cheminement au collégial et un cheminement au secondaire professionnel (DEP). Après le secondaire, le collégial et le secondaire professionnel se formalisent donc davantage en exigeant une formation standardisée. Universitaire : minimum une maîtrise dans un domaine relié ou connexe à la matière enseignée. À ce moment, tu peux enseigner au baccalauréat comme chargé de cours. Pour enseigner à la maîtrise ou au doctorat, il faut un doctorat (parfois un post-doc). J'espère que cela pourra t'aider. O'Hana
-
Salut gang, À ma connaissance, pas de limite ni dans le nombre d'emplois ni dans la durée d'heures travaillées (souvenir d'informations prises en appelant aux normes du travail l'année dernière). Question très pertinente ! D'un point de vue macro-économique, une hausse des emplois à temps partiel (comme c'est le cas au Canada et au Québec depuis quelques années*) indique non pas une détérioration de la santé économique d'un pays mais une aggravation de la qualité des emplois offerts. Niveau santé économique, le Canada semble bien se porter si l'on se fie aux principaux indicateurs : PIB en croissance, balance commerciale excédentaire, inflation maîtrisée, taux de chômage en baisse, taux d'emploi élevé**. Niveau qualité des emplois, l'emploi à temps partiel augmente ce qui semble démontrer une incapacité des entreprises à proposer une qualité d'emploi satisfaisante. Car un emploi à temps partiel ne favorise pas un plan de carrière, le développement de projets à long terme, la motivation au travail, etc (bref, précarité et atypisme). Après, il s'agit de se questionner sur les motivations à occuper un emploi à temps partiel (est-ce voulu ou contraint ?). Par ailleurs, une hausse de ce type d'emploi peut aussi indiquer une hausse de la flexibilisation tant recherchée par les entreprises pour résister à la concurrence étrangère et rester les plus compétitives possibles. Bref, une richesse économique apparente peut cacher beaucoup de misère sociale. O'Hana * Voir Enquête sur la Population Active de Statistique Canada et tendances du marché du travail de l'Institut de la Statistique du Québec ** Voir dernier communiqué sur les indicateurs économiques de Statistique Canada
-
Je n'en doute pas : à posteriori, l'apport mauresque dans l'histoire de l'Espagne est incontestable d'une richesse extraordinaire (les palais de l'Alhambra à Grenade en sont un très bel et surtout très beau exemple). Ce n'est pas de ce point de vue que j'amenais l'idée du barbarisme. Plutôt du point de vue occidental à l'époque qui voyait dans cette conquête une hérésie à plusieurs niveaux (ce qui rendait la Reconquête encore plus importante). Le rapprochement avec les attentats du 09/11 est probablement tiré par les cheveux mais je le trouve intéressant. En effet, la question générationnelle est présente durant tout le film. Cela peut paraître en effet insultant voire même indécent de voir cette génération de baby-boomers intellectuels être aussi cyniques alors qu'ils ont largement profité de l'euphorie qui régnait à l'époque de leur jeunesse. Cela peut même paraître choquant de voir ces baby-boomers dénoncer la perte d'idéaux des générations actuelles ... Mais quel plaisir incroyable de voir la scène où Girard tempête contre l'Occident qui n'a même pas élevé de monument à l'holocauste des indiens en Amérique du Nord ! Exactement. Bien sûr, on peut voir dans ce film les phénomènes de la mondialisation, des régions éloignées victimes inéluctables du sinistre économique ... Mais en même temps, c'est toute la honte de l'assistance-emploi et la fierté face au sens du travail qui est en filigrane durant tout le film à mon sens ! O'Hana
-
Beau film effectivement. Avec le temps, je comprend mieux le choix du titre - Les Invasions Barbares - ou plutôt, je m'amuse à trouver par moi-même sa signification comme pour mieux comprendre Arcand (sans pour autant lire les critiques sur son film ou ses interviews à ce sujet). Nous aurons tous remarqué la brève scène où l'on voit le gardien de l'hôpital regarder les attentats du 09/11 à la télévision qui illustre, à mon sens, cette crainte des nord-américains face à la montée de l'intégrisme (qui n'est pas sans rappeler la conquête de l'espagne par les Maures il y a plusieurs siècles). Nous aurons tous remarqué la satyre sur l'état du système hospitalier québécois au point de devenir un débat au sein de la société québécoise (faut-il le privatiser ou non avec ce que cela implique en termes de choix de société) qui veut préserver sa différence sociale face à l'ultralibéralisme barbare de leur puissant voisin du sud. Paradoxalement, le fils de Rémy Girard dans le film (Rousseau) personnifie à plusieurs égard ce néolibéralisme par sa profession et les moyens dont il dispose pour que son père puisse bénéficier de conditions d'hospitalisation particulières. Cela vient donc en rajouter à la tension déjà existante dans la relation père-fils (mais c'est savoureux à voir en tant que spectateur !). Alors face à tout cela, cette bande d'amis se réfugie avec délectation dans les souvenirs du passé, dans les plaisirs rabelaisiens de la nourriture et du bon vin, sans oublier les relations intimes et intenses entre eux tous (et avec leurs enfants). Dernier petit clin d'oeil face aux invasions barbares, clin d'oeil littéraire probablement (merci à Jimmy de me l'avoir fait remarquer) : la fin du film montre Marie-Josée Croze face à la bibliothèque de Girard où on peut y voir clairement l'ouvrage de Soljénitsyne - "L'archipel du Goulag" - qui est connu pour avoir combattu la tyrannie. Peut-être une façon d'y voir, une dernière fois, le Québec comme l'archipel d'une certaine culture dans un océan de culture uniformisante à la façon états-unienne, donc barbare d'un point de vue culturel. Les barbares ne viennent plus de l'est comme auparavant : ils sont là, tout autour de nous déjà O'Hana
-
Tout à fait. Le fait que les femmes - québécoises ou non - soient beaucoup moins aux prises avec les questions d'orgueil et de fierté font en sorte qu'elles disposent intérieurement des ressources nécessaires pour chercher de l'aide pour décompresser et éviter ainsi de passer à l'acte. Un psychanalyste québécois connu médiatiquement, Guy Corneau, en a fait d'ailleurs son cheval de bataille : aider les hommes québécois à mieux accepter leurs émotions pour les exprimer au lieu de rester emprisonné dans une éducation qui leur a appris à endurer sans rien montrer. Jusqu'à ce que la corde, trop tendue, cède. Là, il faut s'entendre ce qu'on entend par société développé, riche et prospère : est-ce que ça en fait automatiquement une société aussi riche et prospère sur le plan social ? Les États-Unis en sont un bon exemple. Le Japon également avec son haut taux de suicide. La prospérité a un prix. Et ce prix passe souvent par des maladies professionnelles et ici en l'occurence, par le suicide. Je n'y vois donc rien d'anormal, bien au contraire. Simplement un effet logique. O'Hana
-
Salut la gang, Dans la poursuite de mon hypothèse : La France est une société d'idées alors que le Québec est une société de résultats, premièrement. En second lieu, le Québec a longtemps vécu replié sur lui-même (quasiment 200 ans) où les rôles traditionnels ont été maintenus par la religion, ce qui n'est pas le cas de la France. Autrement dit, cela fait à peine 45 ans que le Québec est cette société moderne que nous connaissons aujourd'hui : 45 ans pour une société, ce n'est pas grand chose. Par évolution de la société, n'oublie pas de mentionner aussi dans les modèles actuels que nous connaissons : hausse de la productivité, hausse des emplois dans les services (où les femmes sont majoritaires), hausse du PIB, hausse des délocalisations, hausse de la méritocratie, de la performance, de l'excellence, du carriérisme ... Bref, autant d'autres éléments qui contribuent également, à divers degrés, au taux de suicide (cf. Japon par exemple) Moi je pense que oui, mais de manière probablement plus nuancé au Québec certainement. Comme le mentionne un forumiste plus haut, les femmes sont plus fortes mentalement que les hommes : leur fragilité n'est qu'apparente. O'Hana
-
Salut la gang, J'ai beau cherché et je ne vois, à date, qu'un événement ne pouvant expliquer le taux de suicide élevé au Québec (et en particulier des québécois) comparativement aux autres sociétés développées : la Révolution Tranquille. Mon hypothèse : le Québec se définit encore, tant dans son imaginaire collectif que dans sa réalité quotidienne, par une certaine masculinité (logique concrète, sens de l'action) héritée en grande partie je pense de la colonisation (que la religion n'a cessé de maintenir pendant plusieurs siècles). Comme si le québécois se rappelait encore de cette époque où il fût un coureur des bois, un trappeur ou un bûcheron ... Autrement dit, cette héritage aurait pu grandement définir l'identitaire de l'homme québécois et plus précisément, aurait pu définir par le fait même son utilité dans la société au sens quasiment stéréotypé du terme : comme on dit en bon québécois, l?homme ramène le bacon à la maison (où sa femme y a fait le ménage bien entendu). Il y a donc un sens très concret, très matériel à l?identité de l?homme québécois je trouve. Comme me le disait un de mes clients un jour : « moi dans la construction, ce que j?aime bien c?est qu?à la fin de la journée de travail, je peux le voir concrètement ce que j?ai fait : mes quatre murs sont levés ou pas ». Bref, la Révolution Tranquille est venue bouleverser tout cela sur plusieurs plans : - en provoquant la hausse des services sociaux suite aux fortes demandes d?un État Providence (enseignement, santé, communautaires, etc), cela a réduit l?utilité de l?homme au sein de son foyer. À la limite, pour élever un enfant, son père ou un programme social qu'importe : tous les deux feront l?affaire - en émancipant la femme de son rôle traditionnel faisant par le fait même exploser la construction historique du foyer : la femme peut maintenant avoir un emploi rémunéré et donc obtenir son indépendance financière et donc réduire encore plus l?utilité de l?homme (qui n?est le plus le seul à pouvoir ramener le bacon à la maison ?) J?appréhende déjà plusieurs lectrices du forum s?exclamer et dire « pauvres petits chéris à qui on a enlevé les derniers restants de virilité ! » et elles n?auraient pas du tout torts dans un sens car c?est vrai Ce qui est plus dramatique, c?est que dans ce grand mouvement de modernité et de libéralisation de la Révolution Tranquille, l?enthousiasme général a oublié de s?attarder à redéfinir AUSSI le rôle de l?homme. Est-ce une coïncidence si les hommes de 20 à 40 ans sont les plus touchés par le suicide ? C?est-à-dire les enfants de la Révolution Tranquille et les enfants de ces enfants ? Bref, une perte de sens identitaire pour l?homme québécois qui perd en même temps le sens de sa vie en perdant son travail (ne ramène plus de bacon). Je ne crois pas que l?homme veut retrouver son ancien rôle traditionnel : il veut juste retrouver un rôle plus à sa mesure dans cette nouvelle société québécoise, ce qui est différent. O?Hana
-
Bonjour, J'ignore ce que tu entends exactement par "programmes du Ministère de l'Éducation" mais peut-être que le lien ci-dessous correspond à ce que tu recherches : Présentation des programmes du préscolaire, du primaire et du secondaire C'est issu du MELS (Ministère de l'Éducation des Sports et des Loisirs du Québec). O'Hana
-
Salut la gang, Vraiment, merci beaucoup pour vos commentaires ! Peut-être est-ce pour cela que ma chronique est courte afin qu'elle se prolonge dans une discussion Nemesis J'apprécie les commentaires "expérientiels" de Schumarette et Bouh qui vivent en région, i.e. dans des centres urbains de petite taille où "l'anonymat" que procure une communauté culturelle ne doit pas être si développée que cela. Au lieu du phénomène d'intégration standardisée que je constate parfois à Sherbrooke, tu sembles vivre une intégration "stigmatisée" apparemment Schumarette car en soulignant tes qualités d'immigrante française (pas une maudite française, etc ; ce qui part d'une bonne intention au départ), on semble plutôt mettre davantage en relief ta différence, ce qui est paradoxal ! Probablement qu'un début de réponse réside dans le fait que le Saguenay constitue une région particulière en soi au Québec. Je me rappelle à cet effet une amie à l'Université qui aimait nous rappeler régulièrement avec fierté qu'elle était saguenéenne, tout comme un autre ami venant de la Gaspésie. Ça n'avait rien de fatiguant : c'était simplement révélateur d'un état d'esprit je pense, i.e. qu'il semble que soit considéré "étranger" toute personne qui n'est pas du Saguenay d'origine (ceci incluant donc les québécois d'autres régions), alors une immigrante d'outre-mer ... J'aime beaucoup tes arguments Kaoumez : même si je crois encore à l'idéalisme français, je constate que la France n'a plus les moyens de ses ambitions sur le plan de l'immigration. À l'inverse du pragmatisme canadien qui semble réussir jusqu'à maintenant à concilier ses devoirs de société d'accueil (réfugiés) et son droit à faire préserver le consensus social (processus immigratoire sélectif). Mais s'il y a un certain irréalisme entretenu artificiellement en France à ce sujet (la républicanité une et indivisible), le multiculturalisme canadien m'apparaît aussi un peu artificielle en refusant de reconnaître le caractère distinctif du Québec par exemple (cette province permettant justement ou paradoxalement au Canada d'être distinct culturellement des États-Unis !). Arslan, j'avoue ne pas comprendre lorsque tu écris que l'auteur (moi en l'occurence si j'ai bien saisi le sens de tes phrases) n'a vu que le bon côté du multiculturalisme en supposant même que je vois tout le monde beau et gentil. Je pose des questions dans ma dernière chronique : je ne les élude pas. Plus encore, dans de précédentes chroniques, je remet en question le multiculturalisme à la Trudeau, j'interroge même l'interculturalisme québécois, je joue même parfois les alarmistes limite prophète de fin du monde La question de l'intégration est complexe : les arrimages que tu suggères Touareg existent déjà sous diverses formes partout au Québec. À Sherbrooke par exemple, le service de francisation du Cégep a un service de jumelage entre immigrants et québécois. Mais ce n'est pas toujours évident. Ex : certains immigrants hispanophones pensent encore qu'ils doivent donner un 100 piasses à la police pour pouvoir déposer une plainte. Ou encore, un autre immigrant n'arrive pas à utiliser les toilettes d'ici car il n'a jamais été habitué à ce modèle et reste encore déstabilisé que les toilettes soient propres ici ...! Il y a des habitudes à "casser" dans un sens pour l'intégration sans pour autant toucher à celles importantes pour l'identité de la personne et enrichissantes pour la société québécoise. L'intégration, c'est parfois de la réciprocité aussi précise qu'une opération chirurgicale. Kathy, si tu t'ennuies durant une lonngue soirée d'hiver, tu sais quoi faire : 1-800-OHANA et je viendrai te jaser une couple d'heures pour que tu puisses t'endormir hi hi O'Hana
-
Salut la gang, Le taux de chômage n'apprend pas grand chose en soi. Selon Statistiques Canada (qui publie mensuellement une enquête sur la population active), un chômeur est une personne sans emploi mais qui a cherché activement du travail au cours des quatre semaines précédants l'enquête. Ainsi, si une personne vue par un agent de StatCan travaillait la semaine juste avant de se faire interrogée, elle ne sera pas mise dans la catégorie des chômeurs (et pourtant, elle est au chômage au moment de l'enquête). Par ailleurs, les statistiques du chômage excluent d'office les personnes ayant renoncé à chercher du travail (donc, qui ne cherche plus activement). Renoncer par choix (ex : mon conjoint gagne suffisamment pour subvenir aux besoins du couple) ou de force (ex : malgré toutes ses tentatives, la personne ne se trouve vraiment pas d'emploi). Dans le renoncement par la force des choses, cela sous-entend un sentiment de démotivation face au marché de l'emploi pouvant exprimer un début de récession économique (même si cela prend deux trimestres consécutifs de stagflation pour que StatCan déclare une récession). Bref, tout ça pour dire que ces gens exclus, s'ils ne l'étaient pas, viendraient gonfler le taux de chômage. Un indicateur économique devenu hautement politisé (comme nous le rappelle sans cesse Paul Martin sur les ondes actuellement avec un taux de chômage le plus bas au Canada depuis trente ans). 1) tous les adultes sur l'assistance-emploi (BS) ne sont pas aptes au travail : probablement aptes physiquement mais pas psychologiquement. L'éducation à la pré-employabilité est devenu aujourd'hui un volet en soi dans les programmes d'aide à la recherche d'emploi. 2) si quantativement il semble qu'il y ait suffisamment d'offre de travail (chercheurs d'emploi) pour la demande de travail (employeurs), c'est là une vision purement économiste de la chose. Ce n'est pas parce que je suis disponible au travail que je suis prêt à faire n'importe quel emploi dans n'importe quelle région du pays : la dimension psychologique est importante. 3) il manque en effet de la main-d'oeuvre dans certains métiers, dans certaines régions et à certaines périodes de l'année et aussi des travailleurs agricoles : cela est probablement dû aussi au fait que les canadiens et les québécois n'en veulent pas de ces emplois. Car, logiquement, s'ils en voulaient, ils les occuperaient ces emplois. Et le pays n'aurait pas besoin des immigrants ni des mexicains. O'Hana
-
Salut, Oui effectivement, on peut appeler cela des emplois aidés en quelque sorte lorsqu'il s'agit d'admissibilité préalable par le CLE. Exemples : - emplois réservés au programme PPTA (Programme Pour Travailleurs Âgés - 55 ans et plus) - emplois bénéficiant d'une subvention salariale (Emploi-Québec contribue à 50% du salaire de la personne bénéficiaire pendant six mois) : généralement, il faut être monoparental ou sans qualification (pas de secondaire V) ou inscrit à un comité de reclassement suite à une mise à pied - emplois rentrant dans le cadre d'un ATÉ (Alternance Travail Études : Emploi-Québec "achète" des places dans des formations et les stages qui y sont reliés sont réservés aux personnes choisies par EQ). Généralement réservé aux jeunes sans secondaire V mais cela reste très global Pour bénéficier de cette admissibilité, il faut rencontrer un agent d'aide à l'emploi du CLE qui, selon les besoins de la personne, peut l'admettre à un des programmes existants sous réserve qu'elle respecte les conditions d'admission. O'Hana
-
Le problème n'est pas dans les chiffres que tu amènes qui sont tout à fait exacts mais uniquement pour la seule année 2004 au Québec. Or, comme dans toutes statistiques, il faut regarder les tendances sur plusieurs années. Et là on peut voir le problème : Naissances et taux de natalité au Québec Décès et taux de mortalité au Québec Source : Institut de la Statistique du Québec (on retrouvera les mêmes chiffres au fédéral car l'ISQ se base sur les données de StatCan) O'Hana
-
S'lut la Plateausarde J'ai lu quelque chose d'approchant : enquête de StatCan sur src.ca/nouvelles où de plus en plus de baby-boomers revenaient sur le marché du travail et l'argent n'était pas la principale motivation. On est une société centrée sur le travail, ça a pas d'allure. Pour ma part, je crois que les baby-boomers actuels finiront par partir. C'est plutôt notre génération qui va devoir rester très longtemps sur le marché de l'emploi, non pas par aliénation au travail (on a compris qu'il y a autre chose que la job dans la vie !) mais pire : par nécessité. Parce que chacun de nous devra payer la pension de deux ou trois retraités à cause de la dénatalité, parce que l'atypisme de l'emploi va croître, parce que le système de santé va exploser, parce que parce que .... O'Hana
-
Salut la gang, Tout comme RedFlag : septième noël au Québec dans mon cas aussi mais qu'un seul passé auprès de ma famille depuis que je suis arrivé ici. C'est rough à chaque année. Mais à tout le moins, ça démontre que j'ai encore un coeur : je ne veux jamais m'habituer à être loin des miens durant le temps des fêtes. Un peu dans le même sens que Monika, avoir sa propre famille doit beaucoup aider. Éventuellement ... O'Hana
-
Salut la gang, Dans ce cas, les planificateurs autant provinciaux que fédéraux devraient revoir leurs copies car le phénomène d'étirement (entre d'un côté des immigrants très qualifiés et de l'autre côté des emplois exigeant peu de qualifications) va s'accentuer. Ce qui serait aberrant considérant la proportion qu'il prend déjà maintenant. D'un point de vue technique, ils ont raison : plus une personne est scolarisée, plus elle augmente ses chances de s'insérer, d'un point de vue global. Encore faut-il pouvoir lui proposer un bassin d'emploi en adéquation avec ses qualifications. Lesdites qualifications laissant entrevoir les aspirations personnelles et les ambitions professionnelles de la personne : on ne fait pas un doctorat pour se retrouver chauffeur de taxi. Même si être chauffeur de taxi est une profession très honorable, il n'en reste pas moins qu'elle ne correspond pas aux aspirations et ambitions d'un universitaire. Retour de bâton cynique du "qui s'instruit s'enrichit" qui a notamment présidé à la Révolution Tranquille du Québec. Ceci étant, l'immigrant paie son immigration et participe à l'économie lorsqu'il s'installe (meubles, achats divers, etc). Je fais essentiellement référence ici aux immigrants économiques. Exact. Il est également exact que le marché du travail a une capacité objective limité d'absorption de travailleurs, qu'on soit immigrant ou pas. Autrement dit : tous ne se trouveront pas un emploi. Et le départ massif à la retraite des baby-boomers créera certes un vide mais qui sera rapidement comblé. Pareil si un assouplissement significatif des ordres professionnels s'opérait : cela ouvrirait des opportunités qui ne seront pas éternelles. Comme le chômage, l'insertion des immigrants m'apparaît donc plus structurel que conjoncturel, cyclique ou frictionnel. Certes. Cela dépend ensuite dans quelle société on désire vivre. O'Hana
-
Salut PP ! Je suis bien d'accord avec toi que le rouleau compresseur états-uniens joue un rôle de standardisation : de manière globale, je ne sais même plus si on peut encore parler de culture mais pas plutôt d'industrie culturelle. À cet effet, j'aime bien ces mots de Richard Langlois :"le monde entier est devenu un immense Club Price où les 3/5 des gens n'ont pas de carte de membre". * Ceci étant, étant notoirement connu sur le forum comme un ardent défenseur du libéralisme, je trouve fascinant que tu puisses faire cohabiter défense des exceptions culturelles et libertarisme économique (hi hi). Fa que, tout ça pour dire que je rejoins Totof06 : O'Hana * Économiste québécois, dans "Pour en finir avec l'économisme". Éditions Boréal (1995).