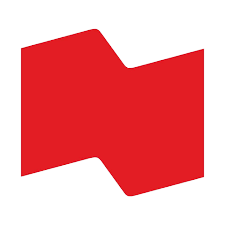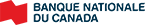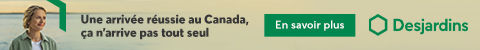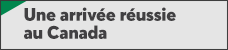O'Hana
Chroniqueur(e) immigrer.com-
Compteur de contenus
4081 -
Inscription
-
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Blogs
Tout ce qui a été posté par O'Hana
-
Salut gang, D'autant plus qu'une réserve de pétrole est dite "prouvée" lorsqu'il s'avère technologiquement rentable de l'exploiter si je ne me trompe pas : ainsi, plus la technologie avance, plus l'Alberta devient un gros joueur dans l'échiquier mondial car il devient désormais rentable d'exploiter ses sables bitumineux. Cela signifie qu'il doit très certainement exister des gisements pétroliers - légers ou lourds - considérés comme étant non encore prouvés. Au début, c'est effectivement une bénédiction. Qui se révèle rapidement une malédiction : tous les pays en voie de développement où il fût découvert du pétrole ont connu de graves difficultés ensuite. Car ces pays peu industrialisés et aux faibles PIB se sont retrouvés du jour au lendemain avec une manne de pétrodollars que leurs économies ont eu beaucoup de difficultés à absorber. Si beaucoup de cet argent a bien été dépensé (infrastructures, écoles, hôpitaux, etc), il y a eu aussi beaucoup de gaspillage : projets pharaoniques, armement à outrance. Toutes proportions gardées, c'était comme si une personne sur l'assistance-emploi avait gagné au loto. Et ces pays s'en foutaient presque de gaspiller des milliards de dollars : dans le contexte d'alors, le pétrole était quasiment une rente confortable et assurée à vie. Le Québec a l'énorme avantage d'avoir une économie diversifiée et non mono-industrielle, une solide ressource hydroélectrique et des mécanismes économiques permettant d'éviter les dérives majeures. Une manne pétrolière serait donc mieux gérée je pense en gelant temporairement, par exemple, une partie de ces pétrodollars pour permettre à l'économie québécoise de les absorber à son rythme. Mais on est encore bien loin de tout cela. Bon lundi matin by the way O'Hana
-
Salut la gang, J'adore le sensationnalisme systématique des médias lorsqu'on touche à l'éducation au Québec. Qu'est-ce qui est le plus important : avoir de futurs enseignants calés en maths mais dotés d'aucune pédagogie ou avoir des enseignants ayant légitimement oubliés certaines notions en maths mais qui auront à coeur de transmettre avec pédagogie cette matière une fois ces lacunes comblées ? Au primaire et au secondaire, l'important n'est pas tant la matière enseignée que la pédagogie pour enseigner la matière. Bien sûr, il faut maîtriser la matière enseignée mais il faut relativiser. O'Hana
-
Salut Pimili, Deux endroits où tu peux trouver réponse à cette question selon moi : - la Commission Scolaire (CS) de la région où tu vas résider. L'éducation à la citoyenneté est en effet une compétence provinciale, donc relevant de chaque ministère de l'éducation (ceci ne permettant donc pas une uniformisation de l'enseignement de ce champ). La CS te redirigera probablement vers un centre d'éducation aux adultes qui dispense des cours à ce sujet - le Carrefour d'Intégration, antenne du MICC dans la région où tu vas résider. Généralement, il te réorientera vers l'organisme communautaire qui dispense des cours à ce sujet si tel est le cas. Pour information, je te donne les grandes lignes des cours d'histoire, de géographie et d'éducation à la citoyenneté donnés aux cycles du primaire et du secondaire dans les écoles québécoises : Présence davantage marquée de la communauté autochtone Étude de trois communautés autochtones avant l?occupation européenne; Étude de l?une d?entre elles deux siècles après l?arrivée des Européens; Étude de deux autres communautés vers 1980. Préoccupation accentuée au regard des réalités patrimoniales Indication de traces de sociétés passées sur la nôtre et notre territoire; Estimation de l?apport de sociétés du passé à la nôtre et sur notre territoire; Indication de traces de changements passés observables aujourd?hui. Inscription d?une approche comparative Ouverture à d?autres sociétés passées ou actuelles, démocratiques ou non; Recherche de ressemblances et de différences dans les organisations sociale et territoriale; Découverte de la variété et de la valeur des cultures. Ouverture sur la vie de personnages individuels et collectifs Étude de l?influence de personnages marquants sur les organisations sociale et territoriale; Étude de l?influence de personnages marquants sur les changements sociaux et territoriaux. Étroite relation entre territoire et société Regards posés par l?élève sur la manière dont les sociétés aménagent leur territoire et s?y adaptent. Inscription formelle de l?éducation à la citoyenneté au programme Préoccupation de formation d?un citoyen ouvert (entre autres, au changement, à la diversité des interprétations, à la différence); Préoccupation de formation d?un citoyen éclairé et responsable (entre autres, par l?apprentissage des opérations du jugement critique); Préoccupation de formation d?un citoyen démocrate (entre autres, par la connaissance des institutions et mécanismes politiques, des droits, des responsabilités et des libertés reconnues par l?État). Initiation à la mise en perspective Passage de la simple localisation dans l?espace et le temps à l?établissement des contextes géographique et historique.
-
Tiens, j'ai cru voir une JayJay passer ... M'a aller voir le lien O'Hana
-
Postez vos photos ici afin de mieux vous connaître.
O'Hana a répondu à un(e) sujet de MR_Nice_Guy dans Lounge
Okay d'abord O'Hana -
Postez vos photos ici afin de mieux vous connaître.
O'Hana a répondu à un(e) sujet de MR_Nice_Guy dans Lounge
Je ne connais pas ce terme ... Je connais le terme "gang" par exemple, prononcé à la québécoise pour effectivement désigner un groupe d'amis au Québec. O'Hana -
Postez vos photos ici afin de mieux vous connaître.
O'Hana a répondu à un(e) sujet de MR_Nice_Guy dans Lounge
Désolé mais sans moi : ça fait nom de prototype secret et moi chu plutôt télétubbie en comparaison Anyway, ma face est en ligne dans la rubrique des chroniqueurs O'Hana -
N'importe quel parti politique pour n'importe quel enjeu électoral souhaiterait cela effectivement : que l'électorat vote pour ses idées ... L'obtention de la citoyenneté canadienne n'est-elle pas fondamentalement l'obtention d'un diplôme ? Ça prend des préalables (avoir 1095 jours de résidence au pays), passer et réussir un examen QCM pour finir avec une belle cérémonie de remise des diplômes, i.e. des certificats de citoyenneté avec un juge et un policier de la GRC en grande tenue pour rendre tout ça encore plus .................. [je vous laisse compléter les pointillés avec bon vous semble] Et on aura compris qu'avec la citoyenneté vient le droit de vote. O'Hana
-
À mes yeux, le résident permanent est la personne au Canada assise entre deux chaises : elle a démontré sa motivation à rester mais rien n'est moins sûr. Elle se situe donc entre, par exemple, l'étudiant étranger qui est au Canada pour un projet d'études uniquement (caractère temporaire) et le citoyen canadien dont toute la vie, théoriquement, s'incarne au Canada (caractère permanent). La question de la temporalité est donc importante. C'est d'ailleurs de cette façon que CIC détermine essentiellement l'admissibilité d'un résident permanent à la citoyenneté canadienne avec la règle des 1095 jours de présence physique au pays. Probablement parce que cela constitue, jusqu'à preuve du contraire, la seule preuve objective du sentiment d'affiliation de l'immigrant au Canada. Autrement dit, la temporalité (1095 jours) s'incarnant dans un territoire donné (le Canada) présument de l'adhésion de l'immigrant au système de valeurs qui y prévaut qu'une reconnaissance juridique finit par formaliser (naturalisation). Hors de cet espace objectivé - à plus forte raison dans un contexte de mondialisation du terrorisme - les éléments subjectifs sont beaucoup trop variables et sujets à discussion, polémique et contestation pour pouvoir recueillir un consensus clair. Ainsi, des éléments tels que la connaissance de l'histoire du Québec, l'attachement émotif, le sentiment très intime de souverainisme ou de fédéralisme ou encore le développement d'un réseau affectif fort sont difficiles à évaluer et à objectiver. C'est pour cela qu'au-delà de la citoyenneté juridique, j'amène effectivement l'hypothèse que seuls les québécois peuvent se prononcer autant rationnellement mais aussi affectivement et éthiquement sur la question nationale. Après, il faut définir le québécois d'aujourd'hui (autre vaste débat). Car il existe aussi une citoyenneté culturelle : après plus de 7 ans ici, puis-je me considérer comme québécois même si je ne suis pas encore citoyen canadien ? Qu'est-ce qui est absurde : qu'un québécois de 18 ans à peine éveillé aux réalités politiques d'un référendum puisse voter ? Ou qu'un résident permanent dans la trentaine, bien informé de la chose, ne puisse pas ? QUI des deux fait le vote le plus éclairé ? Bref, sur quoi doit se baser la légitimité de la chose : le droit de la naissance ou le droit citoyen à savoir ce qui se passe dans sa cité ? Bref, le résident permanent a le cul entre deux chaises : c'est la faute à pas de chance comme dirait l'autre. Mais en attendant, je peux comprendre que les québécois soient réticents à confier une partie de leur destin à des personnes dont, je répète, l'attachement affectif au Québec ne peut jamais être réellement démontré de manière objective. Heureusement d'ailleurs serai-je tenté de conclure : pauvre de nous si nous puissions un jour quantifier ce que fait ressentir en nous UN PAYS. (désolé, pas pu m'empêcher) O'Hana PS : j'ai bien hâte Dariane !
-
Salut gang, Merci bien pour vos commentaires Après réflexion, je crois qu'il est plus juste de tenir les résidents permanents hors du débat de la question nationale en ne leur accordant pas le droit de vote. En effet, la couverture médiatique est telle aujourd'hui qu'un résident permanent peut faire entendre sa voix via un groupe communautaire par exemple et ainsi provoquer une réflexion sur la place publique avant le jour crucial du vote. C'est mieux que rien. Mais c'est infiniment mieux que d'accorder le droit de vote à une catégorie de la population dont la connaissance rationnelle des enjeux liés à la question nationale peut être insuffisante et, surtout, dont l'attachement affectif au Québec est difficilement évaluable. Même le résident permanent le plus informé sur l'histoire du Québec et qui n'est pas encore arrivé ici en sait encore moins, selon moi, que le résident permanent qui est déjà sur place et qui a pu vivre de manière expérientielle les enjeux de la question nationale. Bien sûr, cela dépend de chacun. Et c'est justement cette très grande variabilité et subjectivité qui me fait pencher pour ne pas accorder le droit de vote aux résidents permanents. Je ne suis évidemment pas d'accord avec cette opinion. Lorsque j'étais sous visa de travail, j'étais en situation régulière, je payais des impôts : j'aurai donc pu voter selon ton raisonnement. Pourtant, si mon statut était temporaire, mon vote, lui, aurait pu avoir un caractère permanent et aurait affecté le quotidien de plusieurs millions de personnes mais pas le mien si j'avais finalement décidé de ne pas rester au Québec. Et ce raisonnement est aussi vrai pour le résident permanent : personne ne peut présumer de son avenir au Québec ou au Canada. La citoyenneté est une présomption certes non garantie mais supplémentaire. Sans parler de la dynamique sociologique que cela peut créer : j'achète mon droit de vote en payant des impôts. C'est accorder une valeur marchande à la citoyenneté. Et que faire si je perd ma job comme résident permanent ? Je ne peux plus voter ? O'Hana
-
Une étude réalisée par l'économiste Finn Poschman de l'Institut C.D. Howe pour le compte du Globe and Mail indique que la classe moyenne est, au contraire, plus avantagée par une baisse d'impôt que par une baisse de la TPS. Il s'est basé sur la promesse de baisse d'impôt des libéraux (baisse de 16 à 15% du taux d'imposition du revenu) et sur la promesse de baisse de la TPS des conservateur (de 7 à 6% mais n'a pas tenu compte de celle de 6 à 5% promise d'ici 2010). [1] Par ailleurs, oui, effectivement, les classes les plus défavorisées économisent aussi avec une baisse de la TPS : mais cette économie est tellement marginale (car la majorité de leur budget est consacré à des produits non assujettis à la TPS) ; ce qui n'est pas le cas de l'économie significative réalisée par les classes aisées. Entre l'état et la main invisible, je préfère encore le moins pire de ces deux maux à mon sens, i.e. l'état ... O'Hana [1] Globe and Mail, 12 janvier 2006
-
Même s'il y a effectivement encore beaucoup de travail à faire - et là, je parle d'efforts aussi bien du côté des québécois que du côté des nations amérindiennes et innus - je crois que l'attitude québécoise face aux nations autochtones se démarque positivement comparativement : - à la gestion de la question des Premières Nations par le gouvernement fédéral canadien - à la gestion de la question aborigène par le gouvernement fédéral australien - à la gestion de la question maori par le gouvernement néo-zélandais - à la gestion de la question kanak par le gouvernement français en Nouvelle-Calédonie - à la gestion de la question amérindienne par le gouvernement fédéral états-unien Parfois, ce ne sont pas tant les résultats qui comptent que la volonté. O'Hana
-
Salut gang, Mon expérience personnelle lorsque j'étais sous visa étudiant au Québec (pendant trois ans). Les deux obstacles majeurs que j'ai rencontré : 1] considérant la répartition inégale des centres éducatifs au Québec - en particulier des universités - il y a une proportion significative d'étudiants qui proviennent de l'extérieur et qui ont déménagé dans la ville où se trouve l'université (ou le cégep) uniquement pour les études. Ce sont donc des personnes qui ont déjà un réseau de contacts, qui rentrent souvent dans leur région d'origine la fin de semaine et encore plus quand c'est la semaine de relâche. Pas évident de tisser des liens hors des cours dans ce contexte. Ils sont ouverts à de nouvelles amitiés mais leur réalité fait en sorte que cela risque de durer que le temps de leurs études. Avec ce que cela implique en terme d'investissement personnel dans la relation. 2] comme j'étais sous visa étudiant, j'étais donc ici pour une durée limitée. Avec aucune garantie que je restais au Québec / Canada au terme de mes études. Ainsi, tant que dure cette incertitude, il est difficile là également de s'investir dans une relation d'amitié autant pour les québécois que pour soi-même. Après, cela dépend de la profondeur que vous voulez avoir dans vos relations : personnellement, il a fallu que je me positionne clairement avec des québécois qui devenaient très proches de moi sur le plan de l'amitié. Autrement dit : "j'ai le goût qu'on devienne vraiment chum toi et moi O'Hana mais reconnait que c'est difficile de le faire si on sait que tu risque de t'en aller éventuellement ..." Ils m'ont respecté dans cela. Mais lorsque j'ai décidé de demander ma résidence permanente, cela a débloqué pas mal de relations amicales : non seulement les amis québécois étaient soulagés que je reste ici, mais en plus, ils étaient fiers que je choisisse le Québec comme lieu d'installation et cela les motivait à m'aider du mieux qu'ils pouvaient dans mon immigration. L'avantage d'immigrer au Québec en passant au préalable par les études font en sorte qu'il est relativement plus facile d'avoir des contacts : les études, les travaux d'équipe, les présentations orales, les 5 à 7 font en sorte qu'on a pas le choix de transiger, d'échanger et de discuter avec les québécois. Contrairement à l'immigrant qui arrive seul et doit faire sa place, seul, sur le marché du travail. L'inconvénient est que - comme le dit le point 1] - une fois les études terminés, chacun s'en retourne chez soi généralement, ce qui fait que tu te retrouves avec des amis éparpillés dans la province ou ailleurs. Dans mon cas, il n'y a qu'une amie qui est restée à Sherbrooke : les autres sont dans la grande région de Montréa, Trois-Rivières, Québec, Outaouais, Ontario etc ... Résultat : après plus de trois ans au Québec, j'ai dû me reconstituer un réseau d'amis à Sherbrooke pratiquement comme si je venais tout juste d'arriver ici ! Fin de la tranche de vie O'Hana
-
Salut la gang, Personnellement, je suis partagé. La TPS est une taxe à la consommation : dans ce cas, toute baisse de cette taxe favorise donc la consommation effectivement, mais qui consomme le plus sur la plan qualitatif ? i.e. la personne de la classe aisée qui s'achète un VUS ou la personne de la classe défavorisée qui s'achète son pack de bière journalier ? - ouh le gros préjugé - De toute façon, les personnes de la classe défavorisée consacrent généralement une grande partie de leur budget déjà bien mince au logement et aux produits de base, c'est-à-dire des produits non soumis à la TPS. De fait, une baisse ou une hausse de cette taxe ne change pas grand chose pour eux. Par ailleurs, si vous souhaitez tant relancer l'économie, une baisse d'impôt est préférable à une baisse de la TPS : la TPS ne favorise pas l'évasion fiscale et a peu ou pas du tout d'incidence sur l'épargne, deux effets qui ont beaucoup plus d'importance sur le plan macro-économique qu'une baisse de la TPS. Alors que des impôts élevés, oui. Et je regrette que Mr Boisclair ait refusé l'offre de Legault de récupérer le point de TPS qu'Ottawa cédait avec cette baisse de la TPS. Les coffres du Québec ont bien besoin d'argent. O'Hana
-
Une trilogie, ptete ben qu'oui ptete ben qu'non, on verra ben J'entend bien ta réflexion mais je ne suis toujours pas convaincu que passer directement au vote provincial serait une bonne chose. En partant, bien des québécois connaissent mal certains enjeux cruciaux de leur province (ex : Loi 101, hydroélectricité, péréquation, déséquilibre fiscal, question nationale) : c'est un constat qui est d'ailleurs sensiblement vrai partout dans le monde. Nul n'est prophète en son pays. À plus forte raison, j'estime que cette méconnaissance doit être encore plus grande chez les immigrants reçus pour tout un tas de raisons : ils viennent d'arriver, des soucis plus concrets en tête, l'adaptation psychologique, l'apprivoisement culturel, etc. Dans ce contexte, saisir les enjeux québécois devient un énorme défi. C'est pour cela que maîtriser les subtilités au niveau municipal dans un premier temps m'apparaissent comme étant un bon début. Il est normal qu'au début que l'immigrant soit davantage centré sur lui : plus il réussira à être confortable avec lui-même avec le temps, plus il s'ouvrira en profondeur à ce qui se passe dans sa société d'accueil. O'Hana
-
Salut la gang, Effectivement, c'est Keynes : pour lui, un déficit budgétaire était acceptable dans la mesure où ce déficit, en soutenant la demande effective (ex : assistance-emploi des particuliers), serait rattrapé par les impôts et taxes que l'état récupérerait suite à la consommation issue de la demande effective. Il est donc l'inspirateur - bien involontaire - de l'État-Providence que nombre de pays occidentaux ont mis en place, surtout après le traumatisme économique et social qu'a représenté la crise de 1929 qui a clairement démontré les limites de l'approche néo-classique (qui donnera le libéralisme économique). Certes. Cependant, pour qu'un travailleur de 30 ans fasse rouler l'économie, il faudrait en retour que l'économie lui donne les moyens de rouler lui également. Or, la flexibilité, la précarité et l'atypisme au travail sont de plus en plus croissant dans les marchés du travail occidentaux. Cela crée un sentiment latent d'insécurité ne poussant pas à consommer mais plutôt à épargner, ce qui ne favorise pas l'économie. D'autant plus qu'ils devront supporter une charge accrue sur le plan fiscal car il faudra financer l'explosion des services de santé dû au vieillissement de la population. O'Hana
-
Salut, Bien égoïstement, je considère comme étant une bonne chose que de limiter le nombre d'employé(e)s à quatre dans les épiceries après 17:00 durant la fin de semaine. Les clients ont cinq autres jours dans la semaine pour faire leur épicerie. Et s'ils n'ont pas le temps durant la semaine - comme cette personne qui a deux jobs - ce n'est pas tant les épiceries qu'il faudrait vilipender mais un marché du travail qui n'est pas en mesure de proposer des emplois décents. Et cela permet de limiter l'atypisme dans les emplois de ce secteur - commerce de détail, restauration, etc - qui se caractérisent par des horaires instables, une rémunération de misère et la quasi-absence d'avantages sociaux. Augmenter de nouveau le nombre d'employés dans les épiceries durant la fin de semaine, ça serait suivre la même tendance qui veut que les commerces soient ouverts 24/24. Et ça devrait nous faire réfléchir sur le sens à accorder à nos fins de semaine. La même tendance qui salue la présence croissante de garderies en milieu de travail. Ce n'est pas la disponibilité et la conciliation famille-travail qu'on valorise en faisant cela : c'est le travail uniquement qu'on valorise en organisant toute notre société autour de lui pour nous permettre d'avoir de moins en moins d'excuses de vouloir profiter de la vie, i.e. pour nous inciter à être encore plus performant. Un reportage intéressant hier sur Télé-Québec montrait le stress relié au travail. Rien de nouveau sous le soleil. Jusqu'au moment où ils montraient ces travailleurs qui ont réussi à trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle : finalement, cela leur demandait tellement d'efforts qu'ils étaient devenus stressés aussi ... alors que leur objectif était justement de ne pas devenir stressés comme les autres ! O'Hana
-
Salut, Le Québec a fortement développé le concept d'employabilité qui consiste en gros à actualiser en permanence son profil professionnel : probablement l'héritage du "qui s'instruit s'enrichit" de la Révolution Tranquille et de la théorie néo-classique du capital humain. De fait, la formation - en particulier la formation continue - est très valorisée. Les projets de retour aux études sont donc bien accueillis et acceptés ici. Il existe d'ailleurs un solide réseau d'UTA (Université du Troisième Âge). Dans mon entourage personnel, j'ai au moins trois exemples : - une mère monoparentale secrétaire de formation qui a aligné bacc + maîtrise en orientation à 36 ans - une autre maman monoparentale qui est retourné à l'université à 32 ans pour bacc + maîtrise + doctorat + postdoc en anthropologie. Un projet scolaire de 14 ans qu'elle a mené avec deux enfants à charge ! - un professeur en sociologie qui est retourné, à 55 ans, faire son bacc en droit et qui est maintenant membre du barreau J'enseigne à l'université et j'ai toujours au moins trois ou quatre étudiant(e)s en retour aux études et cela se passe très bien. Ils ne sont pas marginalisés par leurs autres collègues ni par le département, même si on s'entend que la différence d'âge influe dans les interactions, le choix des équipiers dans les travaux de session, les interventions en classe, etc. O'Hana
-
Explication intéressante. Le défi est maintenant de ne pas perdre de vue qu'à titre d'immigrant, je suis le seul responsable autant de la possible idéalisation de mon lieu d'immigration que de la possible amertume que je pourrai développer in fine à son égard. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible de ne pas mener un travail rigoureux de recherche et surtout de recoupement d'informations sur son futur pays d'immigration pour justement éviter idéalisation puis déception. Le sentiment d'échec dans une immigration peut en effet amener la personne à rechercher les raisons de cet échec à l'extérieur d'elle-même car en assumer la responsabilité deviendrait alors trop difficile à porter. Faire de la projection sur autrui devient alors une stratégie qui évite la remise en question personnelle. Est-ce que je donne l'impression de jouer les directeurs de conscience ? Si oui, désolé. Je dois alors faire de la projection car c'est ce que j'ai vécu la première année de mon immigration ici. O'Hana
-
Salut la gang, Selon le site de Citoyenneté et Immigration Canada, l'aide financière aux réfugiés dans le cadre du programme fédéral a une durée maximale d'un an ou jusqu'à ce que la personne réfugiée puisse subvenir seule à ses besoins, selon ce qui se produit le premier. Programmes des réfugiés pris en charge par le gouvernement fédéral O'Hana
-
Salut, En tout cas, ne va surtout pas voir un orienteur : il va te mêler encore plus La réorientation professionnelle sans reprise d'études est en effet tout à fait possible en autant que cela ne soit pas en direction d'une profession réglementée par un ordre ou une association. Pour autant, cela demande évidemment beaucoup d'énergie et d'efforts même si les champs interprofessionnels sont beaucoup moins compartimentés ici (le Québec a développé très fort le concept de transférabilité des compétences, surtout au niveau des aptitudes et des qualités personnelles : polyvalence, gestion de projets, etc). Faire du bénévolat peut constituer en effet une possibilité et cela permet surtout de développer un solide réseau de contacts où on peut se faire un nom, qui si on y met le temps et l'énergie, peut circuler très rapidement et arriver avec le temps à des oreilles intéressantes pour ta réorientation. Tu peux aussi contacter des associations oeuvrant de près ou de loin dans les nouveaux domaines professionnels qui t'intéresse ou encore t'informer des éventuels congrès, colloques, tables rondes ou activités de relations publiques organisés en lien avec ce que tu vises. La formule Alinov est intéressante mais je ne sais pas si elle serait réellement adaptée à ton besoin. Surtout qu'avec une formation en ingénierie, je ne suis pas sûr qu'Emploi-Québec te financerait dans cette formation : le CLE viserait probablement une insertion sur le marché du travail par la voie classique en techniques de recherche d'emploi. O'Hana
-
Merci mesdames pour vos commentaires, Cela m'encourage à persévérer dans ce que j'exprime dans ma chronique O'Hana
-
Salut Jwilili, Technique en Diététique - Collège de Maisonneuve à Montréal O'Hana
-
Salut gang, Pas de chiffres à proposer mais si je me fie à l'émission Second Regard* de Radio-Canada, l'état du catholicisme au Québec dépérit doucement mais sûrement comme c'est le cas dans beaucoup de pays occidentaux. Son avenir est surtout en Amérique du Sud et en Afrique maintenant apparemment. Lors de l'élection de l'actuel pape, les reportages de Radio-Canada rappelaient régulièrement la difficulté de l'église catholique québécoise à renouveler tant ses ouailles que sa prêtrise. Il existe d'ailleurs une sorte de Fond (créé sous Parizeau je pense) dont l'objectif est d'assurer la pérennité des églises québécoises non pas pour des raisons religieuses mais essentiellement architecturales car elles font partie du patrimoine québécois. Or, il semble s'avérer que ce Fonds - placé sous la gestion directe de Mgr Turcotte je crois - sert surtout à chauffer et entretenir les églises les plus "rentables" (i.e. celles dont les paroisses sont encore actives) au détriment de la restauration de toutes les églises. Hé oui, même l'Église est touchée par la rationalisation. Si je me fie à la logique de ton raisonnement, cela signifie donc que lorsque la société québécoise était encore catholicisée, les problèmes sociaux que tu mentionnes n'existaient pas ou, en tout cas, n'étaient pas aussi criants qu'aujourd'hui. Il faudrait avoir des chiffres pour comparer, ce qui sera probablement impossible dans la mesure où, à l'époque, de tels problèmes sociaux ne devaient pas être comptabilisés ou pire, ne devaient pas être considérés comme problématiques. J'ai une lecture différente de la décatholicisation de la société québécoise : l'émergence de ces problèmes sociaux est plutôt l'expression d'un mal-être évident mais qui peut enfin s'exprimer car libéré de l'emprise religieuse. La nuance est importante. Surtout qu'une fois nommé, on peut travailler dessus pour y remédier. À mon sens, ce n'est pas l'actualité de ces valeurs qu'il faut regarder mais davantage l'actualisation de la Pierre sur laquelle la Bible s'est construite. Encore une fois, je distingue religion et spiritualité. Le premier monopolise la gestion du sacré en disant quoi penser alors que le second autonomise la gestion du sacré en rendant chaque personne responsable de sa propre spiritualité et donc en la poussant à définir par elle-même comment et, surtout, quoi penser. O'Hana * Second Regard est une émission à vocation spirituelle qui propose des reportages sur des questions d'actualité concernant toutes les religions
-
Une formation universitaire qui s'adresse à une clientèle qui ne se satisfait pas des baccalauréat pré-établis proposés par l'Université. Ex : bacc en psychologie, en administration, en biologie, etc. C'est le principe de la toune sur un cd : pourquoi j'irai acheter tout le cd alors qu'il n'y a que deux ou trois chansons qui me plaisent dessus ? Je préfère donc une compilation de mes chansons préférés de tel ou tel groupe de musique. Le bacc par cumul de certificats fonctionne exactement sur le même principe. Je regarde parmi tous les certificats proposés trois qui m'intéresse et je les fais : à la fin, l'université me délivre un diplôme officiel de baccalauréat mais en aucune discipline particulière. Parfois, on l'appelle aussi le bacc multidisciplinaire. Cependant, le bacc multi concerne aussi le programme de formation sur mesure qu'une personne veut faire. C'est encore plus poussé que le bacc par cumul car la personne n'a même pas trouvé son bonheur dans les certificats proposés. Mais il faut obligatoirement faire valider le programme de formation par l'Université pour que cette dernière accepte de valider le projet scolaire. Bacc multi ou bacc par cumul, l'important est d'avoir en arrière de ce projet scolaire particulier un projet de carrière bien précis. Parce qu'il est en effet relativement plus difficile de vendre une telle formation après sur le marché du travail car l'employeur ne peut pas la rattacher à une formation standardisée. Prudence donc. O'Hana