
Dela
-
Compteur de contenus
114 -
Inscription
-
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Blogs
Messages posté(e)s par Dela
-
-
Je crois que cela lui plait bien à cette dame de souligner sa différence, de parler "d'eux" et de sa néo-machinchouette.
Je connais beaucoup d'immigrants qui "oublient" qu'ils le sont. Chacun cultive ce qu'il veut...

Mon meilleur ami depuis 20 ans est un Français d'origine, arrivé à l'âge de 6 ans. Il vit à la campagne parmi des Québécois, il est souverainiste (pas obligé, hein!) et sacre contre les immigrants qui ne s'intègrent pas ou qui c**** sur les Québécois. Il a complètement perdu son accent français (lui reste un très très léger soupçon) et pour ma part, j'avais complètement oublié qu'il était aussi Français avant qu'il ne me le rappelle au hasard d'une conversation.
À plus de 50 ans, des comme lui, j'en connais en masse.
Ce que tu me décris ressemble étrangement aux codes pour intégrer une tribu ..... ou une secte.
En gros un immigrant peut devenir Québécois, s'il oublie d'où il vient et renie son passé, s''il apprend à penser comme toi, à parler comme toi et à dire du mal des euzotes, pas comme nouzotes. Et c'est encore mieux s'il fait cela à la campagne, loin de la ville multiculturelle!
Ouf .... heureusement que le Québec n'est pas une dictature

-
Mon intervention n'allait pas dans le sens de dire qu'il n'était pas un "vrai de vrai". Le contraire, même.
Un immigrant fier d'être Québécois, ça se souligne, non?

Mon intervention précédente ne portait pas un jugement sur ton propos en particulier.
Mais puisque tu parles de fierté, j'aimerai bien savoir si tu le considèrerais québécois s'il n'était pas souverainiste (et fier d'être Québécois).
En quoi Facal, arrivé à 9 ans et plus Québécois que, par exemple, Mavrikakis arrivée à 2 mois?
Pourquoi, le fait qu'elle soit très critique sur la société québécoise la condamne à être une néo toute sa vie?
-
Oui mais lui il a le droit de dire ce qu'il pense sans se faire dire qu'il fait du Québec bashing...
 C'est un québécois, c'est pas pareil
C'est un québécois, c'est pas pareil 
Oui, c'est un Québécois pis un immigrant à part ça!

Et oui, c'est même pas un vrai, lui non plus:
Joseph Facal, né à Montevideo en Uruguay le 12 mars 1961, Joseph Facal est arrivé au Québec en 1970.
Et en plus, le boute du boute: il a fait ses études secondaires au collège Stanislas. Horreur!

Heureusement qu'il est souverainiste!
-
Oui mais lui il a le droit de dire ce qu'il pense sans se faire dire qu'il fait du Québec bashing...
 C'est un québécois, c'est pas pareil
C'est un québécois, c'est pas pareil 
Exact ... et c'est pourquoi j'ai choisi d'intervenir sur ce sujet, non pas en disant ce que j'en pense, mais en citant un vrai québécois qui a le droit de dire ce que je ne peux pas.
Comme le disait Catherine Mavrikakis, professeure de français à l'université de Concordia:
Je suis arrivée ici à deux mois. Ça fait quarante et un ans que je suis là, avec eux, et je suis encore néo. Quand j'aurai 90 ans, ils parleront encore de ma néo-québécitude... -
Cela vient d'un Québécois (pas d'un Français adepte de Québec bashing):
http://lejournaldemo...213-052405.html
http://lejournaldemo...215-052207.html
</h3>
<h3>L'anguille et l'éléphantJoseph Facal
Collaboration spéciale
13/12/2010 05h24
Voici une autre chronique qui risque d'être mal reçue. Je m'en fous. Je suis habitué.
Imaginez un bar dans lequel il y a trois clients : le premier gagne 20 000 $ par année, le second gagne 25 000 $ et le troisième 55 000 $. Le revenu moyen des clients est donc de 33 333 $. Tout à coup, un joueur du Canadien, qui gagne 6 millions $ par année, entre. Le revenu moyen dans le bar vient de passer au-dessus de 1,5 million $. Vu de l'extérieur, si on n'a pas les détails, on se dit : ça doit être un bar fréquenté par des riches.
Bref, un calcul peut être juste, mais donner un reflet complètement trompeur de la réalité.
CLASSEMENT
Les derniers résultats du test PISA, réalisé tous les trois ans par l'OCDE, classaient les jeunes québécois de 15 ans dans le peloton de tête mondial en mathématiques et en lecture. On a surtout retenu leur bonne performance en lecture : 496 points pour les Français et 522 points pour les Québécois. Tienstoé! J'ai tout de suite soupçonné qu'il y avait anguille sous roche.
Prenons d'abord une grande inspiration. Nos enfants demeurent bien classés, mais ils perdent quelques rangs de-puis que les Asiatiques participent à l'épreuve. Au-dessus de la moyenne canadienne en 2000, les jeunes du Québec sont maintenant en dessous. Le plaisir de lire recule aussi de façon notable au fil des ans. On ne peut évoquer les jeux vidéo et autres excuses habituelles puisque ce goût grimpe ailleurs.
Les partisans de la réforme ont évidemment claironné qu'elle n'avait pas entraîné la catastrophe appréhendée. Ses détracteurs ont répondu qu'elle devait permettre des progrès que l'on ne voit guère. Mais mon malaise est ailleurs.
ON MESURE QUOI ?
Allez sur le site Internet de l'OCDE et regardez en quoi consiste le test de lecture. Parmi les courts textes que l'épreuve impose de lire, on trouve une facture et une posologie de médicaments. Le test mesure surtout les aptitudes à être fonctionnel dans la vie de tous les jours. Et je ne dis pas que ce n'est pas important.
À l'évidence, notre système éducatif réussit, dans l'ensemble, à outiller les jeunes pour se débrouiller dans la vie, à les mouler pour être fonctionnels sur le marché du travail. Mais nous échouons dans quelque chose que le test PISA ne mesure pas et qui met en cause toute notre société, pas seulement notre système scolaire.
Je parle d'avoir un vocabulaire assez riche pour exprimer toutes les nuances de la pensée. Je parle de la capacité à construire une argumentation et pas seulement à donner une opinion. Je parle de curiosité intellectuelle et de culture générale. Je parle de tout ce qui per-met justement à quelqu'un d'être plus qu'un petit rouage du système économique.
Ce ne sont pas des difficultés de plomberie éducative que nous avons. C'est un problème plus profond, plus diffus, moins mesurable de rapport à la culture, qui est toujours vue chez nous comme quelque chose de non essentiel, réservé à une élite, et non comme un air que tout enfant devrait respirer naturellement. C'est à l'université qu'on s'aperçoit que l'anguille du début s'est métamorphosée en éléphant.
À chaque automne depuis sept ans, j'enseigne, à HEC Montréal, un cours de sociologie à des étudiants qui entrent tout juste à l'université. Nos critères d'admission sont assez exigeants. Nos étudiants ont donc eu de bonnes notes aux paliers précédents. Il y a beaucoup de Français parmi eux.
Mon cours les oblige à analyser, oralement et par écrit, des questions d'actualité. Pour aller au-delà du bavardage, ils doivent construire un raisonnement, savoir l'exprimer et avoir un certain bagage de culture générale.
Ce que je vois
Je suis obligé de constater que, dans mes classes, quand les Français s'expriment, ils ont, en général, une maîtrise de la langue écrite et parlée indiscutablement supérieure à celle des jeunes d'ici. Je ne parle pas ici d'accent pointu, mais d'un vocabulaire plus étendu, qui leur permet de s'exprimer non plus intelligemment, mais plus subtilement. Leur coffre à outils linguistique est mieux garni et davantage maîtrisé.
Quand j'évoque la Révolution américaine ou la Guerre froide, les Français savent généralement de quoi il est question. Les nôtres ont entendu ces expressions, mais ils n'en connaissent habituellement ni le contenu, ni la signification. Les faits ne sont pas non plus ordonnés chronologiquement, et l'importance des uns par rapport aux autres ne ressort pas. Dans leur tête, tout est mélangé comme dans une poche de linge plutôt que bien classé sur des étagères.
Régulièrement, les Français me citeront des auteurs classiques, comme Jean-Jacques Rousseau ou Adam Smith. Les nôtres, jamais. Nous devons maintenant les obliger à citer au minimum deux livres. Sinon, ils n'utiliseraient que l'Internet et ne mettraient jamais les pieds à la bibliothèque. Inutile de me dire qu'il y a des exceptions: il y en a toujours.
Du calme
Vous aurez beau me mettre sous le nez tous les tests PISA du monde, vous ne me ferez JAMAIS avaler que nos enfants ont une maîtrise de la langue écrite et parlée supérieure à celle des Français, pour ne rien dire de la culture générale. Je parle ici de ce niveau de langue et de culture qui permet d'aller au-delà des nécessités de base de la vie. Et je n'aborde même pas le décrochage scolaire.
Je ne blâme personne en particulier, et surtout pas nos enseignants, généralement dévoués et compétents. L'explication est historique : notre société est jeune, nord-américaine, matérialiste et peu confiante. L'école est donc simultanément utilitariste et thérapeutique. Elle veut outiller pour le marché du travail et fabriquer des petits citoyens politiquement corrects.
Il y a deux ans, en Suisse, sur les ondes de TV5, j'ai vu un téléroman québécois sous-titré en français. Quand il y a des journées pédagogiques, les nôtres iront en randonnée écologique plutôt qu'au musée. C'est tout un climat de société, une mentalité qui sont ici en cause. Chez nous, la culture classique est vue comme une vieillerie élitiste et dépassée, et la richesse langagière est considérée comme un snobisme prétentieux.
Nos enfants sont peut-être performants en mathématiques, mais ils ignorent d'où ils viennent. Ils ne savent pas qu'ils se posent des questions auxquelles d'autres avant eux ont déjà répondu. Leurs idées peinent à se frayer un passage à travers les «tsé» et les «genre». Réjouissons-nous de nos progrès, mais gardons-nous une petite gêne.
-
Juste tané de répondre encore et encore les mêmes choses aux français qui sont en territoire conquis dans ces quelques arpents de neige. C'est tout...
1) Ce qui est chiant avec les français, c'est qu'ils savent toujours tout mieux que les autres.
2) typique du français qui ne supporte pas que l'on puisse avoir l'outrecuidance de critiquer ses propos.
3) Les français qui sont en territoire conquis dans ces quelques arpents de neige
Malheureusement, tu n'es pas tanné des expressions toutes faites.
-
Tellement typique du français qui ne supporte en aucun cas que l'on puisse avoir l'outrecuidance de critiquer ses propos.
Navrant...
Guinness, j'aurai adoré que l'on critique mes propos sur le fromage. Mais il semble que toi et certains sont incapables de formuler le moindre argumentaire. Le désert total.
En effet, Navrant ...
-
Avez vous été faire un tour dans le lounge, visionner le "caméra café" sur les français ?

Parce que je trouve que les dernières pages de ce sujet pourrait pas mal illustrer la vidéo....

Ouais, c'est à peu près cela.
Je me vois très bien dire que Diane Tell nest pas Française, mais Québécoise et me faire répliquer pleins de mots doiseaux

-
Ce qui ennuyant avec les Québécois, c'est qu'ils connaissent peu leur histoire et en plus, dès qu'on ose écorcher leurs certitudes (fantasmes?), on se fait traiter:
1) de méprisant, d'inconscient, d'utiliser une mauvaise documentation? (Zogu)
2) de prendre les Québécois pour des colons (toi)
AS-tu fait le test du Maudit français ?
J'ai eu 17 sur 20. C'est-tu correct ou bien je risque l'excommunication?
Je peux aussi faire mon auto-critique ou bien répété 100 fois:
- -Tout ce qui sort de la bouche dun Québécois est vrai et courtois. Tout ce qui sort de la bouche dun Français est pédant et méprisant . sauf si celui-ci est génétiquement modifié et certifié non maudit-Français.
- -Je ne chercherai plus à me poser des questions, à argumenter et ne discuterai plus le consensus collectif, les idées reçues et la doctrine officielle.
- -Le fromage et le vin ont évidemment été inventés par les Québécois, tout comme le train à grande vitesse et les fusées spatiales (Bombardier), la pénicilline (Jean Coutu), le papyrus (Cascadus), la lunette astronomique ( Farhat), etc.
-
Pour en revenir au sujet:
Celui-ci est bizarrement énoncé et est équivoque.
Parle-t'on:
1) De ce dont les Québécois actuels ont hérité de leurs ancêtres de Nouvelle-France, Français bien-sur, mais les Français de cette période n'ont pas grand chose à voir avec ceux d'aujourd'hui. Donc il faudrait chercher quel héritage de la France d'avant le milieu du 18e siècle reste vivant en 2010 en France et au Québec et voir s'il y en a en commun.
Et à mon avis, à part la langue française, pas grand chose.
2) De ce dont a hérité le Québec des différentes vagues de l'immigration française au Québec depuis le début du 20e siècle et là, le sujet est vaste et assez polémique puisque les apports des immigrants sont souvent minimisés.
Je me rappelle d'une conférence de presse, il y a quelques années ou Eric Debargis (ancien président de l'Union Française), à moins que ce ne soit François Lubrina de l'AFE, regrettait qu'aucun média au Québec ne se soit jamais intéressé aux apports et contributions des Québécois d'origine française (nés en France) au Québec, ce qui aiderait à briser les stéréotypes notamment. A mon avis, c'est tombé dans l'oreille d'un sourd (je rappelle que la France est le pays de naissance hors Québec le plus important des résidents du Québec, ensuite c'est l'Italie et Haïti.
Finalement, je me permet d'user du droit de réplique à Ensaimada.
Zogu fait une affirmation que je trouve gratuite et erronée et qui concerne l'histoire du fromage au Québec. Je donne mon avis que j'argumente. Et les seuls arguments (très courtois d'ailleurs) qu'on me sort c'est que je suis méprisante, je prend les Québécois pour des colons, que ce n'est pas mon histoire, mes luttes, ma culture donc que je dois la fermer parce que je ne suis pas une vraie Québécoise. J'aurai aimé qu'on me donne des arguments un peu plus étoffés et non pas de l'émotionnel à fleur de peau. Quant à l'argument de l'oncle de ma tante qui avait une cave à vin, puis du reblochon, je me permet de rappeler encore une fois l'adverbe SURTOUT (qui veut dire principalement, plus que toute autre chose). Ainsi si tu lis correctement le texte sur l'histoire du fromage au Québec, tu verra qu'il n'est pas incompatible avec toi, ton oncle et ta belle-sœur:
1) En 1960, la production de fromages fins ne représentait que 8 % de la consommation (elle est passée à 46 % en 1987). Toi et ton oncle faisiez donc partie des consommateurs de ce 8% (il y a 50 ans). Je pourrais te chercher les pourcentages de consommation d'alcool dans les années 60 (bière vs vin), mais je doute que cela t'intéresse vraiment, tu as déjà ton opinion définitif, verrouillé.
2) Dans les années 1950-1970, des savoir-faire ont été importés par des ressortissants français, suisses, allemands, grecs, italiens, hollandais, danois et juifs venus s'installer au pays. Le travail de ces importateurs s'avère précieux, car il fait connaître de nouveaux fromages aux consommateurs québécois.
3) À la fin des années 1960, la croissance des importations de fromages de spécialité au port de Montréal atteint 20 % ou plus par année. (dont le Reblochon?)
Aux modérateurs: Fin de la digression pour moi.
-
En passant, notre « engouement » pour les bons vins et les fromages ne datent pas d'il y a vingt ans. Nous sommes sortis du bois bien avant cela. J'ai l'impression parfois que les Français s'imaginent qu'il y a encore du « colon » en nous.
Ensaimada,
Ce qui ennuyant avec les Québécois, c'est qu'ils connaissent peu leur histoire et en plus, dès qu'on ose écorcher leurs certitudes (fantasmes?), on se fait traiter:
1) de méprisant, d'inconscient, d'utiliser une mauvaise documentation? (Zogu)
2) de prendre les Québécois pour des colons (toi)
Ben oui, C'était la grande noirceur jusqu'aux années 60 et la révolution tranquille, l'expo 67 ... hé bien, cela fait seulement 40-50 ans et pas 3 siècles. Il faudrait finir par l'accepter.
En quoi le fait de dire que le fromage (hors Cheddar frais ou non, tranché ou non), le vin, le pain genre baguette, la restauration hors cuisine canado-chinoise, étaient peu développés il y a 30-40 ans, renvoie une image de colons.
A moins que ne pas paraitre colon soit le boute du boute, un peu comme les Russes, Ukrainiens d'aujourd'hui qui font tout pour ne pas paraitre soviétique (l'insulte suprême).
Bon pour revenir à nos fromages:
Pour ceux qui mettent continuellement le fromage d'OKa comme exemple de la tradition québécoise du fromage, je rappelle que le fromage d'Oka est né à la fin du 19e siècle des connaissances acquises par le père Alphonse Juin, qui fabriquait déjà un fromage renommé, le Port-Salut, alors qu'il résidait en France.
Pour un bon reportage sur les produits laitiers au Québec (ben oui, il y a aussi les yaourts qui ne sont populaires au Québec que depuis peu):
http://www.radio-can...0321/lait.shtml
Enfin, une petite histoire du fromage au Québec:
1865-1890 : Implantation progressiveLes premières fromageries du Québec se sont implantées dans les Cantons-de-l'Est, à
proximité de la frontière américaine. La première aurait été érigée en 1865 à Durham,
dans le comté de Missisquoi (Fournier, 1995). Au début des années 1860, les Québécois
importaient du fromage, mais en 1870, ils en ont exporté un demi-million de livres
(Guay, 1992). Déjà en 1871, on comptait 10 fromageries pour ce même comté (Fournier,
1995). C'est à Rougemont, en 1872, que les francophones ouvrirent leur première
fromagerie pour être ensuite imités par les paroisses avoisinantes (Fournier, 1995). Ce
mouvement d'implantation s'est propagé dans les autres régions du Québec à partir de
1890 (Fournier, 1995). Cette implantation a été favorisée par la conjoncture nordaméricaine
des années 1860 et par la demande britannique en produits laitiers qui est
devenu, à cette époque, un marché privilégié pour les cultivateurs canadiens (Guay,
1992).
Voyant l'importance de l'industrie laitière, le gouvernement québécois autorisa, en
1882, la création de la Société d'industrie laitière de la province et encouragea également
la création de fabriques-écoles. Devant le nombre croissant de fabricants, cette société fut
remplacée, en 1891, par un système de syndicats de fabriques et d'inspecteurs ambulants
(Fournier, 1995). Entre 1868 et 1906, l'exportation du fromage a connu une croissance
géométrique (Guay, 1992). Désirant exercer un contrôle sur cette industrie, le
gouvernement ordonna à partir de 1912, que toutes les fabriques soient enregistrées et
que les fabricants détiennent un certificat de compétence de l'École de laiterie de Saint-
Hyacinthe, seule institution accréditée par le gouvernement (Fournier, 1995).
Parallèlement à ces mesures visant à améliorer cette industrie viennent s'ajouter des
découvertes et des innovations technologiques telles que les progrès enregistrés dans le
domaine de la réfrigération artificielle, l'introduction du séparateur-centrifugeur en 1882
et, finalement, le développement du réseau routier et ferroviaire. (Fournier, 1995).
1890-1920 : Expansion rapide
La production fromagère de l'époque est essentiellement celle du cheddar. Le Canada
en produit et en exporte beaucoup grâce à son appartenance au Commonwealth. À la fin
du XIXe siècle et au début du XXe siècle, quelque 200 millions de livres de cheddar
fabriqué au Canada, dans de petites fromageries paroissiales ou locales, quittent les
campagnes en train pour l'exportation. Le Québec en produit pour le marché anglais et
selon le goût anglais, mais il se distingue, pour sa propre consommation, par son intérêt
pour le cheddar frais (MAPAQ, 2004).
Cette phase se traduit par une diffusion intense des établissements à la grandeur du
territoire (Fournier, 1995). Pendant cette période, le nombre a grimpé jusqu'à 348
fabriques combinées (beurre et fromage), 669 beurreries, 605 fromageries et 57 postes
d'écrémage pour un total de 1679 usines de transformation (Côté, 2005). Le sommet a
atteint le nombre 2 142 (1 062 fromageries) en 1911 grâce à la production de fromage qui
connaît une croissance extraordinaire (Guay, 1992). La qualité des produits est cependant
le point faible d'une industrie laitière en développement rapide (Guay, 1992).
L'entrée en jeu de nouveaux pays producteurs donne un coup dur à l'industrie laitière
canadienne bien qu'elle ait eu un court répit pendant la Première Guerre mondiale (1914-
1918). La fin de la guerre marque la fin de la prospérité de l'industrie fromagère
québécoise. Les principaux éléments responsables sont le contrôle insuffisant du lait, le
trop grand nombre de fabriques, le système d'inspection inadéquat et la qualité inférieure
du produit. À cela vient s'ajouter la concurrence des autres produits laitiers (Fournier,
1995).
1920-1950 : Concentration des entreprises
Les années 1920 furent catastrophiques pour l'industrie fromagère québécoise en
raison de l'effondrement des prix du cheddar sur les marchés. Les fabricants ont alors
délaissé le fromage pour se tourner vers la production de beurre (Fournier, 1995). Le
commissaire fédéral de l'industrie laitière J.-A. Ruddick est d'avis qu'il faut faire
disparaître les fabriques en « bout de planche » si le Canada veut concurrencer la
Nouvelle-Zélande et augmenter la qualité de ses produits laitiers (Guay, 1992).
L'arrivée de Kraft en 1921 avec son fromage fondu a aussi été un élément majeur
avec lequel les petites fabriques devaient composer. En plus de cette importante société
privée, plusieurs coopératives se sont formées à cette époque cherchant aussi à accaparer
leur part du marché. NUTRINOR, AGRINOVE et AGROPUR sont des exemples
d'imposantes coopératives qui sont nées pendant cette période (Fournier, 1995).
Ne parvenant plus à compétitionner avec les grands, plusieurs fabriques ont fermé
leurs portes même après la tentative du gouvernement canadien de relancer l'industrie du
cheddar pendant la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de cette guerre, on note une
baisse significative de plus de 50 % de la production fromagère tant québécoise que
canadienne (Fournier, 1995). Les fabriques de fromage voient leur nombre réduit à 320
en 1931.
1950-1970 : Restructuration
En 1950, on comptait plus de coopératives que de particuliers dans la gestion des
établissements laitiers d'autant plus que les législateurs provinciaux et fédéraux aidaient
financièrement les petites entreprises à se fusionner (Fournier, 1995). Cela a amené les
entreprises à se diversifier dans la production de divers produits laitiers tels que le beurre,
le yogourt, la crème glacée et la poudre de lait pour pallier les fluctuations du marché et
diminuer les coûts d'exploitation et de mise en marché (Fournier, 1995). Parmalat
Canada et Saputo inc. sont des exemples d'entreprises de l'époque qui ont fusionné et
diversifié leur production. La dernière est maintenant d'envergure internationale
(MAPAQ, 2004).
La période des années 1950 aux années 1970 est aussi caractérisée par l'amorce du
développement de la fromagerie, qu'on nomme à cette époque « fromagerie de
spécialité » (MAPAQ, 2004). Dans ces années, des savoir-faire ont été importés par des
ressortissants français, suisses, allemands, grecs, italiens, hollandais, danois et juifs venus
s'installer au pays. Le travail de ces importateurs s'avère précieux, car il fait connaître de
nouveaux fromages aux consommateurs québécois et canadiens et il donne lieu à une
demande suffisante pour que puisse s'installer une fabrication locale (MAPAQ, 2004).
L'école de laiterie a aussi contribué à l'évolution des fromages de spécialité au Québec
en faisant la démonstration et l'adaptation, entre autres, des fromages gruyère, richelieu,
gouda, bleu etc. (Fournier, 1995).
À la fin des années 1960, la croissance des importations de fromages de spécialité au
port de Montréal atteint 20 % ou plus par année. C'est alors que le bureau du ministère de
l'Agriculture du Canada, responsable du contrôle et de la compilation des volumes
transités aux fins d'inspection et d'étiquetage, réalise les possibilités que représente ce
phénomène pour l'industrie. Quant au ministère de l'Agriculture du Québec, son travail
de conseiller, jumelé à l'apport qu'il fournit pour appuyer et faire connaître ces nouveaux
produits, prépare la première vague d'implantation de la fine fromagerie au Québec
(MAPAQ, 2004).
1970-1995 : Nouvel essor
Cette période est principalement caractérisée par la naissance de nouvelles
productions de fromages de spécialité et le cheddar frais du jour est en plein essor
(MAPAQ, 2004). En 1960, la production de fromages fins ne représentait que 8 % de la
consommation; elle est passée à 46 % en 1987 (Guay, 1992). Ces productions éprouvent
cependant des difficultés, car l'approvisionnement est irrégulier et insuffisant, surtout
l'automne et l'hiver, un temps de l'année où l'on note une baisse de la production de lait.
Ces difficultés sont éprouvées par les petites et moyennes entreprises qui produisent non
seulement des fromages fins, mais aussi du fromage cheddar frais ou destiné au
mûrissement (MAPAQ, 2004).
La principale difficulté des années 1980, outre l'approvisionnement en lait, est de
faire connaître les produits et de lutter contre un préjugé très courant selon lequel les
fromages importés seraient meilleurs parce qu'ils sont faits en Europe, où l'on possède un
savoir-faire traditionnel (MAPAQ, 2004).
L'industrie laitière du Québec était aussi très critiquée par les autres provinces
canadiennes en raison de la trop grande part de marché qu'occupait la production du
beurre et de poudre dans l'utilisation de son lait (MAPAQ, 2004). La diversification des
produits fabriqués au Québec en vue de la production de fromages fins était donc
stratégiquement importante pour le maintien du plan national du lait; c'est pourquoi, au
début de 1984, on a fondé l'Association des fabricants de fromages du Québec qui
regroupa les entreprises intéressées à travailler à la mise en marché des fromages
(MAPAQ, 2004). L'Ontario, à cette époque, produisait un plus grand volume de
fromages de spécialité que le Québec (MAPAQ, 2004).
En 1990, la tendance à la concentration força les coopératives laitières à se regrouper
pour faire face à la concurrence des entreprises privées, nationales et multinationales, et
s'inscrit ainsi dans le mouvement de mondialisation des marchés (Guay, 1992). En 2003,
le Québec comptait 103 fromageries sur son territoire (MAPAQ, 2004), nombre qui ne
cesse de croître depuis.
-
Et alors? Vous connaissez une autre région d'Amérique où il y a cet engouement pour les fromages artisanaux et de lait cru?
Nous, mais cette engouement ne date que de 20 ans. Même chose pour l'engouement pour la cuisine et le vin.
Elle est actuellement extraordinaire pour l'Amérique du Nord .... mais ne date que de 20 ans. Et cela ne lui enlève rien.
Nier ce fait, s'inventer une tradition millénaire, fantasmer son histoire en faisant fi de la réalité historique, fabriquer sa mémoire collective, ce n'est pas très sain

-
ps: Prétendre qu'il ne se faisait que du cheddar au Québec avant les années 1990, c'est de l'exagération pure. Du mépris, de l'inconscience, une mauvaise documentation?
Oh lala, on monte sur ses grands chevaux!
Si vous savez lire:
Mais, après la Conquête, la production s'est limitée SURTOUT au cheddar, fromage d'origine anglaise.
-
L'amour du VRAI fromage (celui de lait cru!)
C'est une blague, j'espère!
Histoire du fromage au Québec:
Au Québec, les colons de la Nouvelle-France ont apporté avec eux leurs traditions en matière de fabrication de fromages. Mais, après la Conquête, la production s'est limitée surtout au cheddar, fromage d'origine anglaise.
Années 1980: le retour à la terre et aux valeurs traditionnelles insuffle une nouvelle vie à la production de fromages fins. L’arrivée en sol québécois d’un artisan-fromager d’origine suisse, Fritz Kaiser, attise l’engouement des producteurs québécois pour les fromages traditionnels européens. Plusieurs s’intéressent donc à la production de fromages dits « de spécialité » et leurs produits commencent à remporter des prix dans des concours internationaux.
Fin des années 90: des micros fromageries ont vu le jour, dans différentes régions du Québec, pour nous offrir une panoplie de fromages artisanaux dont plusieurs fabriqués à partir de lait cru.
Donc de 1763 à 1990: le gène amour du vrai fromage était plutôt endormi

-
L'empreint à l'anglais du terme arena est masculin (vous avez écrit cette aréna, au lieu de cet aréna) d'après l'office de la langue francaise du Québec. Ce qui est d'ailleurs étrange puisque arena vient du latin à l'origine (arène) et est donc féminin en latin.
Sinon pour le texte: les Québécois manifestent de temps en temps, surtout dans des marches annuelles organisées par des groupes et des associations (toujours les mêmes). Les Irlandais à la St-Patrick, les Souverainistes à la St-Jean, les Gais et Lesbienne à la gai pride, les FFQ à la journée contre la violence faite aux femmes.
Exception: la marche bleue. Mais disons que j'aurai été plus impressionnée si les gens de Québec avaient manifesté contre la corruption et le copinage. Mais pour cela, je pense que le Québec est loin d'être en marche!
-
rions un peu
dans Lounge
Ah ben, je pense que c'est le premier sketch sur les Français qui me fasse rigoler depuis longtemps.
C'est vrai que le dernier que j'avais vu ne m'avait franchement pas fait marrer, c'est le moins que l'on puisse dire.
-
Les fonctionnaires et les gouvernements ont depuis longtemps essayé d'envoyer des immigrants vers les régions et vers la ville de Québec. Déjà en 1994, le gouvernement du Québec avait créé le Fonds de développement de l'immigration en région afin d'encourager la régionalisation de l'immigration. Dans leurs plans quinquennaux, ils prévoyaient atteindre 25% d'établissement hors Montréal, ce qui n'est évidemment jamais arrivé. Les immigrants sont malheureusement libres de choisir de s'établir ou ils veulent. Heureusement que les réfugiés n'ont pas ce privilège: c'est ainsi que pendant très longtemps (jusqu'au début des années 2000), 50% des installations à Québec étaient celles de réfugiés assignés à cette région. Hors les réfugiés sont de moins en moins nombreux en proportions au Québec-Canada.
Outre les réfugiés, les Européens (Français et Belges) formaient en 2006 36% des immigrants à Québec.
Et voila en gros la dualité de l'immigration dans la ville de Québec: des Européens assez à l'aise et des réfugiées qui rament depuis des années.
Quand aux locaux, les Européens sont pris pour des touristes de passage (avec un gros signe de Euros sur le front) et les non blanc catholiques comme des habitués du BS, des aides de toutes sortes, qui doivent surtout pas, en plus, la ramener avec leurs accommodements.
Conclusion: le maire Labeaume devrait travailler autant sur les futurs candidats à l'immigration que sur sa population pur-laines.
Enfin il y a un truc qu'il semble avoir déjà décidé: tout miser sur les Belges et les Français
-
70% du personnel du Collège est recruté localement, donc Québécois
Pas forcément, je pense que ce sont plutôt des enseignants français en contrat local (c'est à dire qu'ils ne payent pas la prime d'expat)
Si ce sont des Français en contrat local ... ce sont donc des immigrants reçus (canadiens potentiels 4 ans après leur arrivée) ou des Canadiens d'origine française. Définition de Québécois: personne de nationalité canadienne qui réside au Québec
-
70% du personnel du Collège est recruté localement, donc Québécois
Pas forcément, je pense que ce sont plutôt des enseignants français en contrat local (c'est à dire qu'ils ne payent pas la prime d'expat)
En effet, est-ce 70% du personnel au complet ou 70% du personnel enseignant qui est recruté localement?
70% du personnel au complet.
-
lecteur dvd
dans Lounge
En général, plus le lecteur est cheap (et chinois) plus il est facilement dézonnable. Le dernier que j'ai acheté date de plusieurs années et c'était un philips acheté à Wallmart. Voici la bible du dézonage (le Philips DVP642 semble être un bon candidat): http://www.videohelp.com/dvdhacks?dvdplayer=&hits=50&topcomments=List+all+by+Hack+Comments Cela fait longtemps que j'utilise plus de lecteur DVD, plutôt le WESTERN DIGITAL WD TV HD Media Player qui permet de lire les fichiers mkv et autre avi HD. Les derniers films que j'ai vu en 1080i (copies de disk blu-ray) sont tête de turc et l'arnacoeur .... qui viennent à peine de sortir au cinoche ici

-
OK, une parfaite inconnue (même si ce n'est pas le cas de sa mère) au Québec devient la nouvelle miss météo de Canal.
So what?
-
C'était, ce soir à Stanislas, la rencontre entre les parents des nouveaux élèves et les membres de la direction. Voici certaines informations intéressantes données par le Proviseur: 70% du personnel du Collège est recruté localement, donc Québécois. 40% des élèves détiennent la nationalité français et 70% la citoyenneté canadienne. Environ 50% des nouveaux élèves (de la pré-maternelle à la Terminale) étaient scolarisés l'an dernier en France ou à l'étranger dans un lycée français. L'autre 50% vient du système québécois. 98% des bacheliers de Stanislas continuent leurs études à l'université québécoise. Enfin pour la petite Histoire: le Collège Stanislas a été créé à l'origine par le sénateur Dandurant pour donner une éducation moins rigide et plus ouverte sur le monde que celle des écoles du Québec contrôlées par le clergé québécois (ex: les livres de Voltaire étaient interdits dans les écoles). Le Clergé québécois s'est opposé à ce que cette école prenne le nom de Lycée Stanislas car le mot Lycée avait une connotation trop laïque. Ce fut donc le Collège Stanislas et un membre du Clergé québécois devait être sur le conseil d'administration. Le dernier est parti en .... 1976! Sur le sénateur Dandurant: http://www2.parl.gc....3b-1d39e452fd86 . Et pour la toute petite histoire, Pierre-Karl Péladeau a été au Collège Stanislas.
-
ciao,
je voudrais savoir combien le prix d'un adaptateur 110/220 V au Québec? et est ce c'est mieux d'amener avec moi un adaptateur ou bien il vaut mieux l'acheter au québec? parceque je vais amener avec moi mon téléphone portable qui phonctione v220, 50Hz, et autres apareils électronique qui fonctionnent par 220 V. ce quer nécessite un adaptateur.
merci.
es-tu certain que tes appareils ne sont pas déjà en 110V/220V ? c'est écrit dessus tout simplement ...
Excellente question ... puisqu'un adaptateur de prise ne coute que quelques dollars. Normalement la plupart des produits électroniques sont en 110V/220V. Même chose pour le portable. Et vérifier s'il est quadband (incluant UMTS 850-1900 et GSM 1900).
-
Je vous remercie tous pour vos conseils. Sur le principe, j'aurais préféré mettre ma fille dans une école québécoise pour que toute la famille s'intégre plus facilement, même si c'est pour 2 ans maxi. Si le programme est le même qu'en pensez-vous??
Auriez-vous dans ce cas là, des écoles à me conseiller?
Encore merci d'avance pour vos réponses.
Ça, c'est le stéréotype commun: choisir l'école québécoise pour l'intégration!
Les écoles à programme francais (Stanislas et Marie-de-France) SONT des écoles québécoises!
Le pourcentage de présence de petits Francais est faible (25%-30%). En plus, si on enlève les enfants des couples mixtes nombreux (franco-québécois), ce taux diminue.
Le reste des élèves sont des Québécois pur-laines et des néo-Québécois de toutes origines.
Donc, il n'y a aucun problème d'intégration en allant à l'école française, comme les enfants de Trudeau, de Charest et d'autres politiciens. Parizeau, Couillard, et autres personnages politiques, ne sont pas moins québécois parce qu'ils ont étudié dans le programme français.
sur ce point je suis d'accord avec toi,
par contre comme tu a l'air de t'y connaitre,
peut tu nous dire si les enseignants sont français ou québécois,
car le pédagogie peut être vraiment différente si il s'agit de profs venant de France vs des profs d'ici.
Il y a 3 types de personnel:
Les expatriés, les résidents et les contrats locaux
L'agent recruté local est recruté par l'établissement scolaire ou le comité de gestion avec lequel il a signé un contrat conforme au droit local. Les recrutés locaux peuvent être de nationalité française ou étrangère, et occupent aussi bien des postes d'enseignants, que des emplois administratifs, ou des postes de personnels ouvriers et de services.Il est vrai que certains postes sont réservés aux titulaires de l'Éducation nationale française.
Mais il n'y a rien d'étonnant là: si un professeur essaie de rentrer dans une école privée (Brébeuf, Jean Eudes, etc.), non seulement il doit être de haut niveau, mais aussi avoir une expérience solide dans la classe ou il va enseigner. Les professeurs qui enseignent dans le système québécois n'ont pas l'expérience du système français. Par contre, pour les cours extra-scolaires (sport, musique, théatre, etc.), le personnel est évidemment québécois.
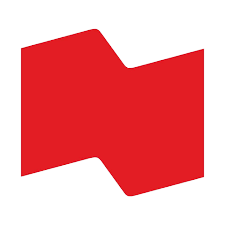


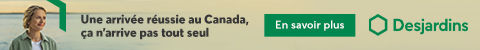



Montréal tombe-t-elle en ruine ?
dans Québec
Posté(e) · Modifié par Dela
Écrit il y a bientôt 10 ans:
http://www.ledevoir....ncore-des-ponts
Tiré du PLAN DE GESTION DES DÉPLACEMENTS RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL POUR UNE DÉCONGESTION DURABLE, Ministère des Transports, Avril 2000
http://www.mtq.gouv....04400144F0104BD
Et des rapports, commissions, études, expertises, etc., il y en a eu des tonnes depuis 20 ans. Mais au pays de l'immobilisme, cela ne va jamais plus loin.