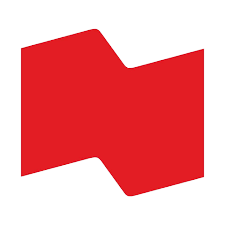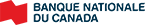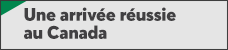texte intégral ***************************************************************** Le rêve d'une vie meilleure de centaines d'immigrants diplômés se transforme souvent en une véritable course à obstacles Clairandrée Cauchy Édition du samedi 1er et du dimanche 2 mai 2004 Le Devoir Le Québec ouvre grandes ses portes à des immigrants scolarisés, spécialisés dans des professions en demande. Pour plusieurs, l'Eldorado tourne au désenchantement quand vient le temps de faire reconnaître leur formation pour intégrer le marché du travail. Le Devoir s'est entretenu avec quelques-uns d'entre eux. Médecin ou dentiste dans leur pays d'origine, ils travaillent comme infirmier ou assistante dentaire en attendant que leur formation soit reconnue. Leur rêve d'une vie meilleure a cédé la place à une véritable course à obstacles digne des Douze travaux d'Astérix. Que ce soit en raison de différences culturelles, des exigences légitimes pour réglementer une profession ou d'une application rigide des règlements, le résultat est le même : plusieurs immigrants sombrent dans un no man's land administratif. S'ils reconnaissent la nécessité d'une mise à niveau de leurs connaissances, ils se cognent souvent le nez à un système incapable de leur fournir une formation complémentaire sans tout reprendre à zéro. C'est le cas d'Ahmad Ali Jamil, 43 ans, un médecin afghan qui travaille comme infirmier dans un hôpital de la rive sud. Peu après son arrivée en 1996, le Collège des médecins lui reconnaît la moitié de sa formation en médecine générale et l'ensemble de sa spécialisation en pédiatrie, complétée en URSS. «J'ai frappé à plusieurs portes pour avoir un stage de mise à niveau, en vain. J'ai aussi tenté de m'inscrire en médecine, on m'a refusé parce que j'avais déjà un diplôme», raconte M. Jamil, en entrevue au Devoir, qui a complété depuis un baccalauréat en sciences infirmières. Il reconnaît que «les connaissances universitaires acquises dans le tiers monde ne sont pas les mêmes que dans les pays développés» . Il n'a donc pas tenté de passer l'examen du Collège des médecins. «Je n'avais pas les moyens de me consacrer à temps plein à l'étude pour mettre à jour mes connaissances, surtout sans soutien financier pour payer le loyer et nourrir les enfants», explique M. Jamil, qui a fait vivre sa famille de cinq personnes à même les prêts et bourses pendant trois ans. Il prend néanmoins la situation avec philosophie et s'attelle à assurer un «avenir excellent» à ses enfants. Manque de formation d'appoint Il n'est pas le seul dans cette situation. Bon an mal an, environ 1500 d'immigrants formulent des demandes d'équivalences aux ordres professionnels. De ce nombre, 45 % sont acceptés, 19 % sont refusés et 36 % doivent compléter une formation complémentaire. Ces derniers ont beaucoup de difficultés à aller chercher les compétences manquantes «à la carte» dans les institutions d'enseignement. «Comme on répond mal à leurs besoins, qu'on les soutient peu -- faut bien que la personne gagne sa croûte -- et que la formation est souvent inaccessible, on laisse des gens sur le carreau, dans des emplois qui ne sont pas à la hauteur de leurs attentes au moment d'être sélectionnés», déplore le directeur général du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), André Gariépy. En vertu des règles budgétaires, les cégeps reçoivent du financement pour les étudiants inscrits dans des programmes menant à l'obtention d'un diplôme, rendant peu «avantageux» les cours aux immigrants déjà qualifiés. Du côté des universités, le contingentement et la disponibilité des équipements limitent aussi l'accès aux cours. Dentiste L'orthodontiste argentine Madel Paulazzo, arrivée au Québec il y a près d'un an, déplore elle aussi l'absence de cours de mise à jour des connaissances pratiques. Elle en a lourd sur le coeur contre le processus de l'Ordre des dentistes. «Qui fait la loi fait le piège», voilà le dicton argentin qui vient en tête à la femme de 38 ans. Après avoir déboursé 2000 $ pour l'analyse de son dossier et 2500 $ pour l'examen théorique, elle apprend que la note de passage est haussée de 70 % à 75 %. L'examen lui-même, tenu le 26 mars dernier, lui a laissé un goût amer. «Certaines questions n'étaient même pas liées à la profession, dont une sur la dermatologie. Tout le monde était furieux. Je suis contente de montrer que mes diplômes, je les ai gagnés. Mais encore faut-il que l'examen soit logique. C'est du protectionnisme», s'insurge l'orthodontiste qui a étudié 10 ans dans son domaine, dont deux en Australie et aux États-Unis où elle a complété sa spécialistion. Si elle obtient la note de passage, elle devra se soumettre à deux examens pratiques, dans cinq ou six mois. «Mais c'est difficile quand on n'a pas pratiqué depuis un an ou deux. Je n'ai pas accès à un endroit pour pratiquer», s'exclame la femme, qui gagne sa vie comme assistante dentaire. «Je pense que je peux être utile au Québec. Je ne veux pas être à l'aide sociale ou quêter sur Sainte-Catherine. J'ai étudié longtemps pour travailler», laisse tomber Mme Paulazzo. Il existe une autre façon de recouvrir son permis de pratique : l'Université de Montréal réserve une place en deuxième année pour un dentiste étranger. «C'est une loterie !», dénonce Mme Paulazzo. Peu importe le profil des dentistes étrangers, ils doivent alors poursuivre la formation pendant trois ans. Le vice-doyen de la faculté de médecine dentaire explique que l'université accepte régulièrement plus d'un dentiste étranger en deuxième année, en fonction du nombre d'abandons en première année. «L'an dernier, nous en avons accepté quatre et cinq, l'année d'avant. Je ne me rappelle pas d'un candidat qui se qualifiait et qui n'aurait pas pu intégrer le programme», note Pierre Duquette, soulignant que l'Université de Montréal se démarque déjà des autres pour son ouverture à la réalité des dentistes immigrants. Décalage entre la réalité et les attentes «Il y a un certain décalage entre les attentes des immigrants et la réalité. Pour les jeunes, ça va bien, mais c'est plus délicat pour ceux qui ont entre 30 et 40 ans [et ont] une famille», constate Sophie Fromentoux, du groupe communautaire Alpa, à Montréal. «Lors du recrutement, il faudrait expliquer que cela ne va pas être de tout repos. Certains ont trop d'attentes», observe la conseillère en emploi qui vient surtout en aide à des ressortissants du Maghreb. Et le parcours du combattant ne se termine pas avec l'adhésion à un ordre professionnel, encore faut-il trouver un emploi, sans la fameuse «expérience québécoise». Le MRCI affirme bien préparer les immigrants dès les rencontres dans le pays d'origine. «Le problème, c'est que les gens attendent d'être ici avant de faire les démarches», souligne le directeur des politiques et programmes d'immigration au MRCI, Jacques Robert. Le peu de réunions des comités d'évaluation, les documents manquants ou la traduction des documents peuvent engendrer des délais importants, particulièrement dans les ordres professionnels qui reçoivent peu de demandes. Shafiqa Allayer, 38 ans, en sait quelque chose. Ayant fui l'Afghanistan des talibans en 2001, elle tente de faire reconnaître sa formation de médecin, en s'adressant dans un premier temps au MRCI. Premier obstacle : il lui manque son diplôme. «Mais le ministère ne donnait pas ce document, au moment où je suis sortie de l'école», mentionne Mme Allayer qui a été en mesure de fournir uniquement son relevé de notes. Deuxième obstacle : l'Afghanistan ne répond plus. Jacques Robert du MRCI confirme qu'il est extrêmement difficile de valider les diplômes afghans et somaliens, les gouvernements étant complètement désorganisés. Récemment, on lui a suggéré de passer par l'Ambassade afghane, a Ottawa. «Mais ils ne sont pas certains que cela va fonctionner.» Déterminée à travailler dans le secteur de la santé, Shafiqa tente un retour aux études. Ses documents manquants reviennent alors la hanter. Pas moyen d'être admise en médecine à McGill sans diplôme collégial. Qu'à cela ne tienne, elle se rend au cégep. Le Collège Dawson la renvoie au secondaire. «Rendue là, j'ai oublié cela [les études]», s'exclame la femme qui travaille maintenant au Centre communautaire des femmes sud-asiatiques. Originaire du Salvador, Victor Regalado s'est aussi buté aux exigences administratives du réseau de l'éducation. Sans emploi, après avoir fait cinquante-six métiers, le Salvadorien -- connu pour la bataille qu'il avait menée dans les années 80 pour être reconnu comme réfugié -- tente de s'inscrire en 2001 à une attestation d'études collégiales en multimédia, commanditée par Emploi-Québec. Déjà détenteur d'un baccalauréat en communication de l'UQAM complété en 1987, il joint son diplôme universitaire à sa demande. Le Collège Montmorency refuse sa demande parce qu'il n'a pas fourni son diplôme d'études secondaires. «C'est une erreur de jugement, un manque de professionnalisme. Un diplôme universitaire du Québec vaut autant sinon plus qu'un diplôme d'études secondaires», s'étonne Victor Regalado, qui vit au Québec depuis 1982. Il a déposé une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour discrimination. Dans un jugement rendu en mars, le Tribunal des droits de la personne lui a donné raison et a condamné le Collège à lui verser la somme de 28 577 $, en dommage matériels et moraux. Groupe de travail ministériel Au fait des difficultés vécues par les immigrants qualifiés, la ministre des Relations avec les citoyens et de l'Immigration, Michelle Courchesne a formé le mois dernier un groupe de travail sur la reconnaissance des équivalences, présidé par son adjointe parlementaire, Diane Legault, auparavant directrice de l'Ordre des dentistes. «C'est assez inconcevable qu'une personne qui exerçait bien sa profession dans son pays ne puisse plus le faire ici et doive recommencer son cours au complet. [...] Je comprends la préoccupation des ordres de maintenir la qualité des services pour protéger le public. Par contre, il y a quand même des améliorations à apporter au niveau de la lenteur des processus», croit la ministre Courchesne. Le comité devrait rendre public un document en juin en vue d'une consultation à l'automne. Le rêve d'une vie meilleure de centaines d'immigrants diplômés se transforme souvent en une véritable course à obstacles Clairandrée Cauchy Édition du samedi 1er et du dimanche 2 mai 2004 Le Devoir Le Québec ouvre grandes ses portes à des immigrants scolarisés, spécialisés dans des professions en demande. Pour plusieurs, l'Eldorado tourne au désenchantement quand vient le temps de faire reconnaître leur formation pour intégrer le marché du travail. Le Devoir s'est entretenu avec quelques-uns d'entre eux. Médecin ou dentiste dans leur pays d'origine, ils travaillent comme infirmier ou assistante dentaire en attendant que leur formation soit reconnue. Leur rêve d'une vie meilleure a cédé la place à une véritable course à obstacles digne des Douze travaux d'Astérix. Que ce soit en raison de différences culturelles, des exigences légitimes pour réglementer une profession ou d'une application rigide des règlements, le résultat est le même : plusieurs immigrants sombrent dans un no man's land administratif. S'ils reconnaissent la nécessité d'une mise à niveau de leurs connaissances, ils se cognent souvent le nez à un système incapable de leur fournir une formation complémentaire sans tout reprendre à zéro. C'est le cas d'Ahmad Ali Jamil, 43 ans, un médecin afghan qui travaille comme infirmier dans un hôpital de la rive sud. Peu après son arrivée en 1996, le Collège des médecins lui reconnaît la moitié de sa formation en médecine générale et l'ensemble de sa spécialisation en pédiatrie, complétée en URSS. «J'ai frappé à plusieurs portes pour avoir un stage de mise à niveau, en vain. J'ai aussi tenté de m'inscrire en médecine, on m'a refusé parce que j'avais déjà un diplôme», raconte M. Jamil, en entrevue au Devoir, qui a complété depuis un baccalauréat en sciences infirmières. Il reconnaît que «les connaissances universitaires acquises dans le tiers monde ne sont pas les mêmes que dans les pays développés» . Il n'a donc pas tenté de passer l'examen du Collège des médecins. «Je n'avais pas les moyens de me consacrer à temps plein à l'étude pour mettre à jour mes connaissances, surtout sans soutien financier pour payer le loyer et nourrir les enfants», explique M. Jamil, qui a fait vivre sa famille de cinq personnes à même les prêts et bourses pendant trois ans. Il prend néanmoins la situation avec philosophie et s'attelle à assurer un «avenir excellent» à ses enfants. Manque de formation d'appoint Il n'est pas le seul dans cette situation. Bon an mal an, environ 1500 d'immigrants formulent des demandes d'équivalences aux ordres professionnels. De ce nombre, 45 % sont acceptés, 19 % sont refusés et 36 % doivent compléter une formation complémentaire. Ces derniers ont beaucoup de difficultés à aller chercher les compétences manquantes «à la carte» dans les institutions d'enseignement. «Comme on répond mal à leurs besoins, qu'on les soutient peu -- faut bien que la personne gagne sa croûte -- et que la formation est souvent inaccessible, on laisse des gens sur le carreau, dans des emplois qui ne sont pas à la hauteur de leurs attentes au moment d'être sélectionnés», déplore le directeur général du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), André Gariépy. En vertu des règles budgétaires, les cégeps reçoivent du financement pour les étudiants inscrits dans des programmes menant à l'obtention d'un diplôme, rendant peu «avantageux» les cours aux immigrants déjà qualifiés. Du côté des universités, le contingentement et la disponibilité des équipements limitent aussi l'accès aux cours. Dentiste L'orthodontiste argentine Madel Paulazzo, arrivée au Québec il y a près d'un an, déplore elle aussi l'absence de cours de mise à jour des connaissances pratiques. Elle en a lourd sur le coeur contre le processus de l'Ordre des dentistes. «Qui fait la loi fait le piège», voilà le dicton argentin qui vient en tête à la femme de 38 ans. Après avoir déboursé 2000 $ pour l'analyse de son dossier et 2500 $ pour l'examen théorique, elle apprend que la note de passage est haussée de 70 % à 75 %. L'examen lui-même, tenu le 26 mars dernier, lui a laissé un goût amer. «Certaines questions n'étaient même pas liées à la profession, dont une sur la dermatologie. Tout le monde était furieux. Je suis contente de montrer que mes diplômes, je les ai gagnés. Mais encore faut-il que l'examen soit logique. C'est du protectionnisme», s'insurge l'orthodontiste qui a étudié 10 ans dans son domaine, dont deux en Australie et aux États-Unis où elle a complété sa spécialistion. Si elle obtient la note de passage, elle devra se soumettre à deux examens pratiques, dans cinq ou six mois. «Mais c'est difficile quand on n'a pas pratiqué depuis un an ou deux. Je n'ai pas accès à un endroit pour pratiquer», s'exclame la femme, qui gagne sa vie comme assistante dentaire. «Je pense que je peux être utile au Québec. Je ne veux pas être à l'aide sociale ou quêter sur Sainte-Catherine. J'ai étudié longtemps pour travailler», laisse tomber Mme Paulazzo. Il existe une autre façon de recouvrir son permis de pratique : l'Université de Montréal réserve une place en deuxième année pour un dentiste étranger. «C'est une loterie !», dénonce Mme Paulazzo. Peu importe le profil des dentistes étrangers, ils doivent alors poursuivre la formation pendant trois ans. Le vice-doyen de la faculté de médecine dentaire explique que l'université accepte régulièrement plus d'un dentiste étranger en deuxième année, en fonction du nombre d'abandons en première année. «L'an dernier, nous en avons accepté quatre et cinq, l'année d'avant. Je ne me rappelle pas d'un candidat qui se qualifiait et qui n'aurait pas pu intégrer le programme», note Pierre Duquette, soulignant que l'Université de Montréal se démarque déjà des autres pour son ouverture à la réalité des dentistes immigrants. Décalage entre la réalité et les attentes «Il y a un certain décalage entre les attentes des immigrants et la réalité. Pour les jeunes, ça va bien, mais c'est plus délicat pour ceux qui ont entre 30 et 40 ans [et ont] une famille», constate Sophie Fromentoux, du groupe communautaire Alpa, à Montréal. «Lors du recrutement, il faudrait expliquer que cela ne va pas être de tout repos. Certains ont trop d'attentes», observe la conseillère en emploi qui vient surtout en aide à des ressortissants du Maghreb. Et le parcours du combattant ne se termine pas avec l'adhésion à un ordre professionnel, encore faut-il trouver un emploi, sans la fameuse «expérience québécoise». Le MRCI affirme bien préparer les immigrants dès les rencontres dans le pays d'origine. «Le problème, c'est que les gens attendent d'être ici avant de faire les démarches», souligne le directeur des politiques et programmes d'immigration au MRCI, Jacques Robert. Le peu de réunions des comités d'évaluation, les documents manquants ou la traduction des documents peuvent engendrer des délais importants, particulièrement dans les ordres professionnels qui reçoivent peu de demandes. Shafiqa Allayer, 38 ans, en sait quelque chose. Ayant fui l'Afghanistan des talibans en 2001, elle tente de faire reconnaître sa formation de médecin, en s'adressant dans un premier temps au MRCI. Premier obstacle : il lui manque son diplôme. «Mais le ministère ne donnait pas ce document, au moment où je suis sortie de l'école», mentionne Mme Allayer qui a été en mesure de fournir uniquement son relevé de notes. Deuxième obstacle : l'Afghanistan ne répond plus. Jacques Robert du MRCI confirme qu'il est extrêmement difficile de valider les diplômes afghans et somaliens, les gouvernements étant complètement désorganisés. Récemment, on lui a suggéré de passer par l'Ambassade afghane, a Ottawa. «Mais ils ne sont pas certains que cela va fonctionner.» Déterminée à travailler dans le secteur de la santé, Shafiqa tente un retour aux études. Ses documents manquants reviennent alors la hanter. Pas moyen d'être admise en médecine à McGill sans diplôme collégial. Qu'à cela ne tienne, elle se rend au cégep. Le Collège Dawson la renvoie au secondaire. «Rendue là, j'ai oublié cela [les études]», s'exclame la femme qui travaille maintenant au Centre communautaire des femmes sud-asiatiques. Originaire du Salvador, Victor Regalado s'est aussi buté aux exigences administratives du réseau de l'éducation. Sans emploi, après avoir fait cinquante-six métiers, le Salvadorien -- connu pour la bataille qu'il avait menée dans les années 80 pour être reconnu comme réfugié -- tente de s'inscrire en 2001 à une attestation d'études collégiales en multimédia, commanditée par Emploi-Québec. Déjà détenteur d'un baccalauréat en communication de l'UQAM complété en 1987, il joint son diplôme universitaire à sa demande. Le Collège Montmorency refuse sa demande parce qu'il n'a pas fourni son diplôme d'études secondaires. «C'est une erreur de jugement, un manque de professionnalisme. Un diplôme universitaire du Québec vaut autant sinon plus qu'un diplôme d'études secondaires», s'étonne Victor Regalado, qui vit au Québec depuis 1982. Il a déposé une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour discrimination. Dans un jugement rendu en mars, le Tribunal des droits de la personne lui a donné raison et a condamné le Collège à lui verser la somme de 28 577 $, en dommage matériels et moraux. Groupe de travail ministériel Au fait des difficultés vécues par les immigrants qualifiés, la ministre des Relations avec les citoyens et de l'Immigration, Michelle Courchesne a formé le mois dernier un groupe de travail sur la reconnaissance des équivalences, présidé par son adjointe parlementaire, Diane Legault, auparavant directrice de l'Ordre des dentistes. «C'est assez inconcevable qu'une personne qui exerçait bien sa profession dans son pays ne puisse plus le faire ici et doive recommencer son cours au complet. [...] Je comprends la préoccupation des ordres de maintenir la qualité des services pour protéger le public. Par contre, il y a quand même des améliorations à apporter au niveau de la lenteur des processus», croit la ministre Courchesne. Le comité devrait rendre public un document en juin en vue d'une consultation à l'automne.